On n’en a – toujours – pas fini avec les partis (2/2)
Après un détour historique et géographique dans le premier volet de ce texte, revenons à présent au cas français pour réfléchir sur les formes contemporaines les plus discutées dans notre pays du lien partisan et sur les entreprises de rénovation voire de dépassement de la forme partisane classique, ceux que l’on appelle les « partis du système », « la caste », « les partis traditionnels », voire les « partis de gouvernement » (terme indigène et politologique désignant les organisations qui ont exercé durablement le pouvoir).
Ces partis ont intégré les contraintes de l’exercice du pouvoir, à savoir mobiliser l’État et tenter de satisfaire les opinions publiques. Ils ont acquis une forme de réalisme qui peut s’apparier avec des formes de renoncement qui, au nom du refus d’une dissonance entre programme et promesses politiques et réalisations « policistes » (des politiques publiques), acceptent désormais de privilégier « l’expertise » contre l’imagination idéologique.
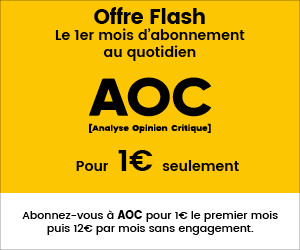
La croissance des « nouvelles technologies » n’a pas changé fondamentalement les données du problème et n’a pas miraculeusement permis une transformation de la répartition des ressources au sein des groupements (le mythe de l’horizontalité), mais a sans doute transformé les formes et la vitesse de circulation des informations.
Les dirigeants des « vieux partis » français n’ont pas attendu les mobilisations mouvementistes pour tenter de régénérer leurs modes de fonctionnement et, à défaut de réinvestir les anciennes pièces de répertoire parfois désormais, en tous les cas en France, abandonnées ou sous-traitées, ont tenté d’afficher une bonne volonté démocratique, parfois empesée ou surjouée pour annoncer et introduire des outils de remotivation et de remobilisation militantes ; comme l’usage de certaines formules de démocratie dite participative, l’activation des réseaux sociaux et l’appel à l’horizontalité, l’ouverture des partis à des sélections par des primaires partisanes. Les résultats ont été très
