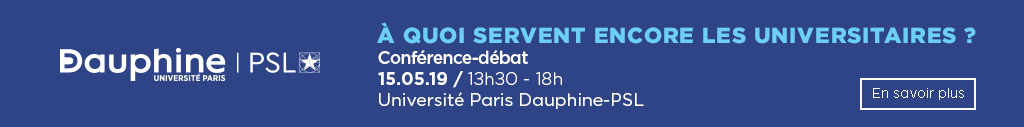Timothy Morton : « Pour la pensée écologique, l’aliénation ne vient pas du passé mais du futur »
Philosophe britannique, Timothy Morton est professeur à Rice University, au Texas. Paru il y a huit ans en version originale à Harvard University Press, La pensée écologique vient seulement d’être traduit en France par Cécile Wajsbrot, et publié aux éditions Zulma. C’est un livre ambitieux, qui poursuit l’entreprise de Timothy Morton depuis plusieurs années : débarrasser l’écologie du concept de nature. C’est aussi un penseur de l’anthropocène, qui nous invite à ne pas nous laisser tétaniser par l’ampleur des enjeux. Il veut même nous aider à les penser, à les concevoir au moyen d’inventions conceptuelles comme les « hyperobjets » — le réchauffement climatique, les déchets radioactifs — ou les « étranges étrangers » — animaux, objets industriels, virus informatiques. Rencontre avec un philosophe qui nous invite à penser grand pour relativiser la toute-puissance de l’homme sur Terre. RB
Le quotidien britannique The Guardian vous a baptisé « le philosophe prophète de l’anthropocène »…
Il faut peut-être commencer par définir ce qu’on entend par anthropocène, et à titre personnel je m’en tiendrai à la stricte définition scientifique. L’anthropocène signifie simplement qu’on retrouve dans la croute terrestre des matériaux d’origine humaine, et que cette couche n’a fait qu’augmenter depuis un certain temps. D’une certaine façon, parler d’anthropocène c’est admettre que les problèmes doivent être posés en termes géologiques. C’est aussi une façon plus précise, plus explicite de nommer notre période géologique, plutôt que de le faire à partir du nom de celui qui la découvre. Ce mot marque la catastrophe. Attention, j’emploie ce mot en ayant conscience que le fait que nous respirions de l’oxygène est le produit d’une catastrophe, celle qui touche les bactéries anaerobies qui ont commencé à relâcher de l’oxygène il y a quelques 3 milliards d’années. On pourrait dire que c’était le premier désastre écologique sur Terre, en tout cas pour ces bactéries pour qui l’oxyg