Alain Damasio : « La littérature permet de percevoir ensemble affects, percepts et concepts »
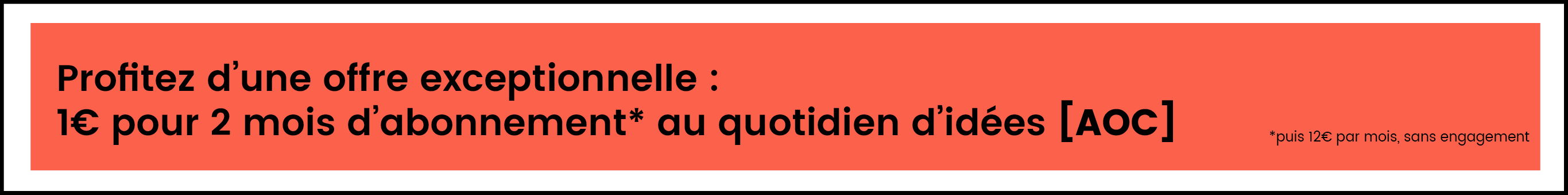
Alain Damasio tutoie tout de suite son interlocuteur, comme on le ferait dans un collectif politique ou un squat. L’écrivain est militant, il avait participé à l’ouvrage collectif Éloge des mauvaises herbes : ce que nous devons à la ZAD (Les Liens qui Libèrent), et s’est exprimé à de nombreuses reprises sur le mouvement des Gilets Jaunes dont il se sent proche. Il faut dire que cette façon de recréer sur des ronds-points des lieux de sociabilité à l’ère numérique, de repenser un commun indépendant des phénomènes de marchandisation, cette remise en cause de l’État qui s’exprime se retrouvent au cœur de ses livres. Dans La Zone du Dehors qui imaginait une société ayant toutes les apparences de la démocratie, mais où le contrôle de tous sur tous débouchait sur la pire des dictatures douces. Dans La Horde du Contrevent, récit polyphonique qui a valu à Damasio le succès qu’on lui connait, il construisait un monde balayé par les vents, qu’un groupe soudé d’hommes et de femmes était chargé de remonter. Dans Les Furtifs, sorti le mois dernier, on retrouve une société de contrôle mise à mal par d’étranges créatures qui vivent dans les angles morts. Á chaque fois, l’invention est politique et poétique, mais aussi typographique. Inventaire des obsessions d’Alain Damasio. RB
Comment êtes-vous venu à la science-fiction ? En avez-vous d’abord été lecteur ? S’agit-il d’un projet littéraire qui n’aurait pas pu s’épanouir sous une autre forme ?
Je suis venu tardivement à la lecture, c’est important de le dire. Ma mère était agrégée d’anglais mais avait fini ses études depuis longtemps, elle lisait très peu. Mon père lui ne lisait pas du tout, à part des bandes-dessinées – on en avait beaucoup à la maison – et l’Équipe. Toute mon adolescence je n’ai lu que ce qu’on me disait de lire à l’école, et des BD. Arrivant en classe prépa, je n’avais aucune culture littéraire. Là j’ai commencé à lire davantage mais toujours dans le contexte de mes études. En fait, c’est lorsque je suis entré
