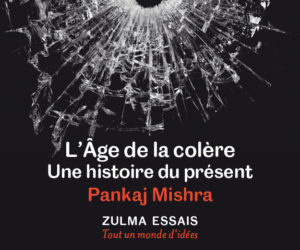Les mains sales – à propos d’Electre/Oreste d’Ivo van Hove
Face à un crime morbide, après l’onde de choc et la sidération premières, les questions affluent, suivant la même ritournelle : pourquoi ? i.e. qu’est-ce qui motive le crime ; et comment ? à savoir comment neutralise-t-on les instances morales et politiques qui nous font, normalement, répugner au meurtre ? Comment dépasse-t-on l’interdit, qui refoule la pulsion de mort, d’autant plus quand cette dernière touche au sacrilège le plus ignoble et condamné : le matricide ? Si le théâtre s’est focalisé ces dernières années plus spécifiquement sur les victimes, l’une de ses principales fonctions est toujours de nous donner à penser la présence de l’inhumain dans l’humain, de nous pousser à faire l’expérience de la nuit.
Avec Electre / Oreste, Ivo van Hove représente un monde sauvage et sanglant. Il revient à la Comédie Française en réunissant deux pièces d’Euripide, justifiant ce rapprochement par leur continuité narrative et par la volonté de montrer la psychologie des personnages dans toute leur amplitude. La barre oblique du titre n’oppose par les frère et sœur, unis non seulement par le sang dans leurs veines, mais aussi par celui versé. Il symbolise bien plutôt le tranchant du couteau qui tue – c’est le slash de la hache de guerre –, et l’entaille par laquelle s’échappe la haine purulente, rémanente, qui pousse au crime.
Lorsqu’on s’attaque à un classique, produit à une époque si éloignée, trois possibilités de mise en scène sont généralement envisagées, que l’on pourrait définir grossièrement ainsi : suivre une démarche archéologique de reconstitution ; viser l’universalité en évitant tout signe des temps trop reconnaissable ; ou chercher à réaliser une adaptation contemporaine.
Mais l’interrogation primordiale est : pourquoi monter de telles pièces, alors qu’elles sont arrachées à leur contexte religieux et politique originel, et que nos sociétés, nos modes d’être au monde, nos imaginaires sont si différents de ceux des Grecs anciens, bien qu’ils en soien