L’impasse post-politique – libéralisme vs populisme 1
Le dépassement du traditionnel clivage qui structure nos démocraties libérales depuis le XIXe siècle entre la droite et la gauche est l’ADN de la macronie. Il est aussi celui des « gilets jaunes » qui se présentent, d’une certaine manière, comme la figure inversée de La République en marche et participent comme celle-ci du nouveau monde. La formation mise en place par Emmanuel Macron pour accéder à l’Élysée s’est imposée sur la scène politique au nez et à la barbe des partis traditionnels avant de se trouver confrontée, une fois parvenue au pouvoir, à un mouvement qui investira le terrain social indépendamment de toute instance classique de représentation syndicale.
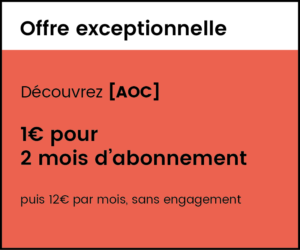
Bien sûr, Emmanuel Macron n’est pas le déclencheur de cette reconfiguration du rapport de forces partisanes au sein de l’échiquier politique et de la société même si le titre de son essai publié en vue des élections présidentielles de 2017, Révolution, le laissait entendre. Il est en revanche permis de saluer l’intelligence politique du candidat qu’il fut, en choisissant le moment opportun pour se présenter au suffrage des électeurs au nom de cette volonté de transcender le clivage gauche-droite.
Mais des causes plus lointaines que l’élection de 2017 expliquent ce dépassement. Une analyse fondée sur une vision de l’histoire qui accorde aux évènements une certaine rationalité objective nous conduit à penser, à la lumière de la grille qu’a utilisée Tocqueville pour comprendre la Révolution française, que ce clivage, telle une charpente vermoulue, était suffisamment essoufflé, avant même l’élection d’Emmanuel Macron, pour que ce dernier puisse facilement lui asséner le coup de grâce. À l’instar des acteurs de la Révolution française qui n’ont fait que prolonger le travail déjà entrepris lors des dernières années de l’Ancien régime par l’action centralisatrice de la monarchie, le président de la République poursuit, sous la bannière de son propre mouvement politique qui occupe le cœur de l’échiquier parleme
