La notion de « post-vérité » saisit mal les menaces cognitives et sociales qui pèsent sur la démocratie
La notion de « post-vérité » s’est beaucoup diffusée dans le vocabulaire politique, journalistique et académique ces dernières années. Ce terme, popularisé en 2016 lorsque le dictionnaire Oxford l’a désigné comme mot de l’année, désignerait une époque historique nouvelle, où les faits objectifs auraient largement perdu leur influence sur l’opinion publique et les résultats des élections. En cause, la possibilité accrue pour les politiciens de mentir, d’ignorer l’avis des experts, de mal se conduire en toute impunité, d’en appeler exclusivement aux émotions et aux préjugés des masses dans la communication politique.
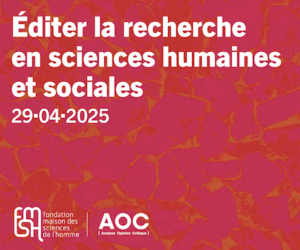
Les mensonges les plus souvent invoqués par les commentateurs de cette ère de post-vérité supposée incluent par exemple ceux du camp leave au sujet des 350 millions de livres sterling que l’adhésion à l’Union européenne était censée coûter à la Grande-Bretagne. Est aussi mentionnée la remarquable insensibilité des électeurs du mouvement MAGA (Make America Great Again) vis-à-vis des mensonges de Trump sur les traitements contre le COVID-19, la supposée fraude électorale de 2020, et son implication dans l’invasion du Capitole en janvier 2021. Le terme de post-vérité est également plus largement invoqué pour décrire des phénomènes de mésinformation de masse, comme le climato-scepticisme, le partage de fake news sur les réseaux sociaux, etc.
Que faire de ce concept d’un point de vue scientifique ? Je pense que ce terme est globalement excessif – et renvoie les lecteurs aux travaux du philosophe britannique Dan Williams qui développe une perspective similaire. Du côté des politiciens populistes, il est vrai que la personne de Donald Trump donne du crédit à l’idée : il ment compulsivement et semble n’en avoir cure, méprise les experts, et il est possible que sa personnalité le positionne plusieurs écarts types en cynisme au-dessus des autres politiciens. Du côté du comportement des électeurs, en revanche, la notion de « post vérité » me semble justifi
