Inviter les programmes dans la danse
En 1927, les écrans de cinéma révèlent la danse d’un robot resté mythique. Loin des représentations habituelles, ce robot prend les traits de la belle Brigitte Helm. Le film Metropolis de Fritz Lang, relate l’histoire d’une ville éponyme empreinte de conflits entre oligarques et travailleurs en l’an 2026. Maria, personnalité clé de la ville dite « basse », est enlevée par le dirigeant de Metropolis. Il ordonne à son savant de créer le double maléfique de la jeune femme. L’actrice incarne donc les personnages de Maria et son alter ego robotique, chargé d’enrayer les révoltes ouvrières.
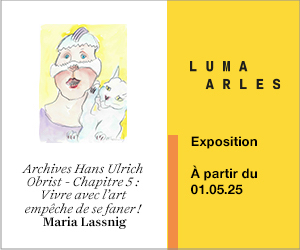
Le robot ne manque pas d’exploiter ses charmes pour manipuler les habitants de la ville. Le film dévoile à cette occasion un numéro de danse grâce auquel le double de Maria hypnotise son public. Le décor et la chorégraphie, chargés d’orientalisme fantasmé, convoquent l’épisode biblique de la danse des sept voiles, en échange de laquelle Salomé demande l’exécution de Saint Jean-Baptiste. Le motif est particulièrement apprécié depuis la fin du XIXe siècle. La tragédie d’Oscar Wilde (1891) et l’opéra de Richard Strauss (1905), présentés quelques décennies plus tôt sur le même sujet, sont également largement inspirés du succès des danses égyptiennes présentées à l’occasion de l’exposition universelle de 1889[1]. Dans Metropolis, cette inspiration de la danse dite « orientale » se manifeste aussi bien par le costume que par la chorégraphie. L’isolement des hanches, les mouvements angulaires, les poignets cassés et le menton avancé véhiculent une série de stéréotypes relatifs à la danse dite « orientale », perçue comme le vaisseau d’un charme enchanteur par l’Occident de l’époque. Encore faut-il remarquer que la fluidité des gestes de la danseuse reste entravée par un rythme soutenu et des mouvements très secs. Ces gestes saccadés ne sont pas sans évoquer la maladresse des mouvements robotiques. La danseuse rappelle ainsi que le corps qui séduit le public est en réalité celui d’un
