Pierre Dardot et Michele Spano : « Les communs désignent une institution du collectif ni étatique ni privée »
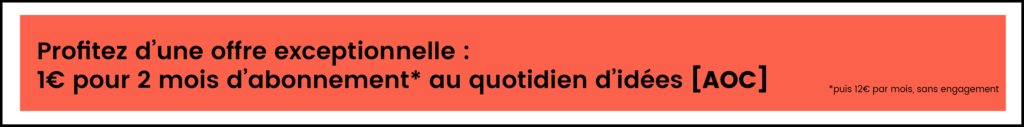
Les communs occupent depuis plusieurs années une place importante dans la pensée critique, surtout depuis la publication en 2014 du livre important de Pierre Dardot et Christian Laval Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle. Le commun y est pensé non pas seulement en termes de biens communs mais comme un processus politique qui permet de s’affranchir de la dichotomie entre public et privé. Pour approfondir cette réflexion, un détour par l’histoire du droit que pratique Michele Spano s’avère particulièrement intéressant. La distinction récente entre droit public et droit privé se trouve en effet bousculée par cette notion de commun, qui offre, par ailleurs, des alternatives à la délégation politique en permettant certaines modalités de démocratie plus directe. La discussion entre le philosophe et le juriste donne ici corps au concept de communs, une idée difficile à saisir tant elle remet en cause nombre de catégories bien établies. RB
Le terme « communs » a émergé ces dernières années dans le débat politique. Mais peut-être convient-il d’abord de le préciser : Pierre Dardot, qu’entendez-vous par ce terme ?
Pierre Dardot — Avec Christian Laval, nous sommes tout simplement partis du mouvement qu’on voyait émerger dans différents pays et qui posait cette question des communs, au pluriel puisque c’est ainsi que le mot est employé par les militants. Ce mouvement regroupait des choses extrêmement diverses, comme par exemple la défense des services publics contre les attaques sournoises qui se menaient de l’intérieur même de l’Etat, pour y intégrer les logiques du privé. Nous nous sommes également penchés sur les luttes autour de questions élémentaires, comme la « guerre de l’eau » de Cochabamba (Bolivie) en 2003. La multinationale américaine Bechtel essayait de faire payer aux paysans l’accès à l’eau, en leur interdisant de continuer – comme ils le faisaient traditionnellement – à récolter la pluie. Cela a donné lieu à un affrontement assez violent, mais surtout
