Faire de la recherche en pleine apocalypse (1/2)
Il a 35 ans. Il s’est déguisé pour passer le barrage de sécurité. Il a troqué ses lunettes rondes contre un monocle et porte un chapeau de chasseur dans le but de lui donner « un air d’aristocrate ». Ce jour de fin d’année 1932 à Francfort, il observe les personnes rassemblées scander le nom d’Hitler. Il est debout, dans la foule, mais comme souvent et pour longtemps, il est seul. Intellectuel, juif, originaire du sud-ouest de la Pologne, il est pourtant assistant au sein de la prestigieuse université de la ville.
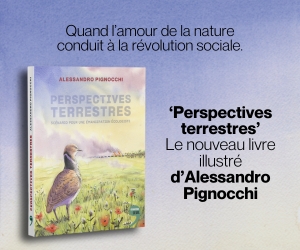
Mais sa jeune carrière a été déjà plusieurs fois interrompue, d’abord par la première guerre mondiale à laquelle il participe, un traumatisme qu’il gardera enfouit tout au long de sa vie ; puis par la crise de 1929, qui ruine sa famille et l’oblige à mettre entre parenthèse son projet de thèse pour gagner sa vie ; mais c’est un mal encore plus grand dont il prend alors la mesure : l’accès au pouvoir du parti nazi. Il s’appelle Norbert Elias[1].
Très vite, il décide de quitter le pays, d’abord pour Paris, puis Londres deux ans plus tard. Durant ces années, il connaît le dénuement, la faim, les tourments de l’exil, l’internement plusieurs mois durant en tant que réfugié allemand, et surtout la culpabilité d’avoir quitté les siens. Anonyme dans la capitale anglaise, il se consacre à un sujet d’étude que l’époque ayant l’apparence en pleine montée des fascismes d’un parfait contre-sens historique : le processus de civilisation.
À partir de visites quotidiennes au musée, il reconstitue la lente évolution depuis le Moyen-Âge des manières de se comporter, de manger, de marcher, de cracher et de s’accoupler dans les pays européens. Selon lui, ces façons de faire se seraient « civilisées », comprendre les normes anciennement imposées de manière coercitives à une population restreinte ont été progressivement intériorisés par une population élargie. Elias a lu Weber après Marx. Il postule que ce processus d’autocontrôle aurait pour envers la monopolisation
