L’hôpital, entre urgences et culpabilisation
La grève qu’ont progressivement engagé les soignant.e.s de plus d’une centaine de services d’accueil des urgences depuis le 18 mars dernier connaît désormais un large écho médiatique. Il faut dire que les pouvoirs publics ont largement apporté leur écot à cette situation.
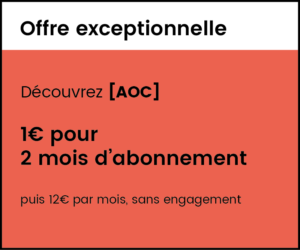
La décision de la préfecture du Jura de faire appel aux forces de l’ordre pour réquisitionner le personnel à l’hôpital de Lons-le-Saunier, ainsi que les propos de la ministre de la Santé, dénonçant un « dévoiement » de « ce qu’est un arrêt maladie », ont sans aucun doute contribué à étendre et durcir le mouvement de contestation, qu’une partie des médecins soutient également.
Les revendications que portent les soignant.e.s en termes de reconnaissance (revalorisation salariale de 300 euros nets par mois) et de moyens (augmentation des effectifs et réouverture de lits d’hospitalisation) sont un seuil sur lequel butte le gouvernement, donnant l’impression de ne pas prendre la mesure du ras-le-bol qui s’exprime. Au-delà de ces éléments très descriptifs, comment analyser la situation ? Qu’a-t-elle de spécifique ? Que dit-elle de la permanence du malaise du personnel soignant ?
En premier lieu, cette mobilisation vient rappeler combien le travail soignant à l’hôpital public reste marqué par l’injonction à la disponibilité et le registre de la culpabilisation. Porter le regard vers le siècle dernier apprend que l’histoire du travail hospitalier est celle de la disponibilité des soignantes sur laquelle l’institution s’est bâtie et qu’elle a entretenue au fil du temps par divers mécanismes.
Si le droit est peu à peu venu rééquilibrer la relation de subordination-émancipation des soignantes vis-à-vis de la tutelle de l’hôpital, l’absence de frontière claire entre les sphères du travail et de ce que l’on nomme le « hors travail », elle, demeure.
Les formes qu’ont pris ces mécanismes ont évolué au fil des années, allant de l’obligation de logement dans l’enceinte de l’hôpital au début du siècle, assortie de j
