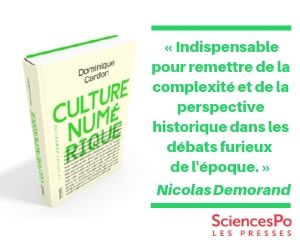Hong Kong : promesses tenues, promesses trahies
Quand Hong Kong a été « rétrocédée » à la République populaire de Chine en 1997, mettant fin à un siècle et demi de colonisation britannique, la Chine s’est engagée à y maintenir la formule « un pays, deux systèmes » (capitaliste et socialiste) et un « haut degré d’autonomie » dans tous les domaines sauf la défense et les affaires étrangères, pour au moins cinquante ans, soit jusqu’en 2047.
Alors qu’on approche du point de mi-parcours (en 2022), Hong Kong vient de connaître un nouvel épisode de manifestations d’une ampleur sans précédent. Celles-ci sont parvenues à faire reculer le gouvernement local sur un projet de loi qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine, mettant en péril la sécurité juridique du territoire. La société civile hongkongaise marque ainsi son attachement fort à l’État de droit (rule of law), véritable pierre angulaire de l’identité hongkongaise, aussi bien sur le plan des valeurs que comme fondement de la prospérité de la ville.
Ces deux manifestations (1 million de personnes le 9 juin et 2 millions le 16 juin, sur 7 millions d’habitants) s’inscrivent dans une série de mobilisations qui peuvent servir de fil conducteur à l’histoire récente de Hong Kong. Après la signature de la Déclaration conjointe sino-britannique en 1984, beaucoup de Hongkongais, bien que préférant un théorique mais impossible statu quo, se résignent au retour à la Chine. Ils n’ont jamais été consultés en tant que tels sur leur avenir, même si certains représentants plus ou moins locaux sont inclus dans les délégations britannique et chinoise. Mais aucun élu hongkongais (il y avait à l’époque des élus dans des instances locales) n’a pu officiellement faire entendre le point de vue de la société hongkongaise.
Hong Kong est une colonie un peu à part, puisque la Chine n’a jamais voulu reconnaître ce statut, afin d’éviter toute possibilité d’invoquer un principe d’auto-détermination.
Pourtant, le camp démocrate, qui entretient des liens avec le mouvement antic