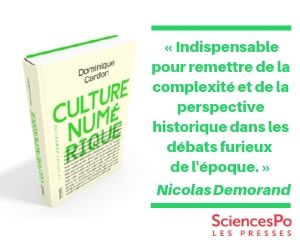Une fille en correction ou la sociologie narrative de Jean- François Laé
Micheline a fauté. Micheline a découché, selon les termes des rapports officiels. Autant dire qu’elle a couché, et que, ce qui devait arriver arriva, Micheline est enceinte. Dans la petite ville de Pernes les Fontaines, près d’Avignon, tout le monde se connait et tout se sait. Nous sommes dans les années 50 et Micheline appartient à ce petit peuple qui s’emploie aux vignes, aux cerises, aux fraises, à leur cueillette et leur mise en conserve. Parce que Micheline échappe, qu’elle fugue, qu’elle fréquente, sa mère ne veut plus d’elle. Il faut dire que Marie, la mère de Micheline, vit chez la grand-mère, depuis que le mari a été emprisonné, puis les a laissées pour refaire sa vie, ailleurs.
Micheline, à 16 ans, le certificat d’études en poche, a pris la route, le Sud, Marseille, Tarascon, Aubagne, et puis le train pour Chambéry, et s’est employée comme bonne de maison. Elle en revient enceinte, se réfugie chez sa mère deux jours, qui la met à la porte. Celle de la tante Augustina reste close, et c’est l’hôpital qui signale la jeune femme de 17 ans qui dort à la rue. L’assistante sociale qui s’occupe de la famille est saisie, et Micheline est placée en mars 1953, à Marseille, au centre de filles mères à la Roseraie. S’ensuit toute une série de lettres. Entre Micheline et sa mère, qui ne répond pas, selon les consignes données par l’institution. Les lettres à la mère se tarissent alors, et prend sa place Mademoiselle, l’intermédiaire, qui devient l’interlocutrice privilégiée.
Mademoiselle, c’est Odile Rouvat, l’assistante sociale, qui réprimande, qui rappelle à l’ordre social, qui rabroue, mais qui aide, envoyant la laine pour la layette, l’argent pour le tissu de la robe de grossesse, et qui, peu à peu, s’attache, encourage, réconforte. Car Micheline, du fond de la Roseraie, a eu une idée de génie : elle a demandé à Odile, Mademoiselle, de devenir la marraine de la petite fille à naître. Et Odile a accepté. Or, dans les années 50, et quand on est catholique c