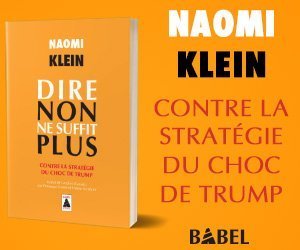Une autre lumière d’août – à propos de Heartland de Sarah Smarsh
Il y a quelque chose de faulknérien dans ce beau livre de Sarah Smarsh, Heartland. Moins introspectif, plus réaliste et autobiographique que le chef d’œuvre de William Faulkner, Lumière d’août (1932), il met en scène également une femme, Sarah Smarsh elle-même, et l’enfant qu’elle a décidé de ne pas avoir, et qu’elle prénomme August, en écho au cycle de la nature qui a bercé son enfance. Le Sud faulknérien laisse la place aux grandes plaines du Midwest, l’un des greniers à blé du pays ; les white trash de l’Ouest remplacent les rednecks du Sud. Tout comme Faulkner, Sarah Smarsh rend visible ces oubliés de l’Amérique dont elle fut dans sa jeunesse.
Pour sa fille imaginaire, elle raconte la vie de femmes sur plusieurs générations dans les terres, ingrates et pauvres, du Kansas. Contrairement au projet faulknérien, Smarsh a des visées sociologiques et politiques immédiates : elle ambitionne de donner des clés pour comprendre ce monde rural en colère, rendu récemment très visible avec l’élection de Donald Trump à la présidence en 2016. Ensemble, la richesse fictionnelle, sociologique, politique et féministe fait de Heartland l’un des ouvrages les plus intéressants pour comprendre l’Amérique contemporaine.
Avant tout, le livre est un récit autobiographique. Sarah Smarsh narre son parcours de « transclasse » qui l’a conduite de la pauvreté des comtés ruraux aux élites universitaires et journalistiques dans le pays le plus riche du monde. En s’adressant à sa fille, elle évoque le parcours des femmes de sa famille dont le parcours fut étonnamment similaire tout au long du XXe siècle mères trop jeunes, malheureuses en couple, dures à la tâche. De la crise de 1929 au triomphe du néolibéralisme dans l’Amérique de Ronald Reagan, leur monde ne cessera de se dégrader.
Si l’auteure n’est pas sociologue, elle en possède l’acuité du regard.
La « modernisation » des campagnes avec l’essor de l’agro-business contribuera à les marginaliser et à les endetter encore plus. Frag