Quand l’information mine le capital
La plus décoiffante des voies d’approche du post-capitalisme vient du théoricien des media d’origine australienne McKenzie Wark, qui prend à contre-pied le présupposé eschatologique et messianiste animant implicitement les annonces récurrentes de la fin et du dépassement du capitalisme : et si cette « autre chose » qui est en train d’émerger de l’auto-consumation du capitalisme, loin d’être la promesse réconfortante d’un avenir radieux, s’annonçait en réalité comme « encore pire » que ce que nous avons connu depuis deux siècles ? Elle n’en resterait pas moins « autre chose » que ce qu’on a pris l’habitude de reconnaître à travers le prisme du Capital ! Et cette « autre chose » n’en demanderait pas moins à être comprise dans ses spécificités et ses dynamiques propres, qu’il faut aller chercher, selon McKenzie Wark, du côté de ce que l’information (numérisée) fait au capitalisme, tout autant que du côté de ce que le capitalisme fait de l’information.
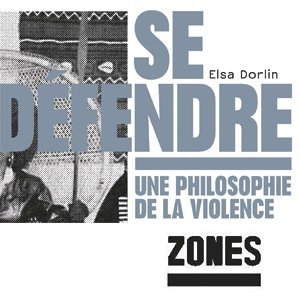
Dans ce domaine, la cause semble aujourd’hui entendue, au grand désespoir des derniers militants naïfs de la cause perdue des « communs », qu’ils soient environnementaux, sociaux ou numériques : après quelques tâtonnements incertains, voire quelques revers initiaux dus à la puissance subversive du pair-à-pair, le capital a su reprendre la main sur le nouveau monde du numérique, célébrant à chaque mois une nouvelle augmentation de la cotation boursière des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) et autres NATU (Netflix, AirBnB, Tesla, Uber). En quelques années, le capital a su trouver le moyen de miner l’information contenue dans nos données personnelles (data mining, big data, speed trading, etc.), pour les revendre au plus offrant. Comme à chaque tour de piste antérieur – après la plantation esclavagiste, après l’industrialisation forcée, après l’usine fordiste – il a su retrouver sa belle inventivité pour extorquer de la plus-value en colonisant cette foi
