« Dessiner une terre inconnue », une géoesthétique de l’anthropocène
L’entrée dans l’anthropocène chamboule le décorum des sociétés. En effet, la découverte de l’ampleur de l’impact croissant des activités humaines sur les systèmes biophysiques planétaires met en péril ce que nous pensions connaître et maitriser. Les valeurs, les imaginaires, les sciences, la création, bref tout cet appareil de médiations idéelles mis en place depuis quelques siècles afin de cadrer l’existence terrestre humaine cède face aux constats de plus en plus nombreux du changement global. S’il y a bien un effondrement qu’on peut déjà observer, c’est celui de la plupart de nos certitudes.
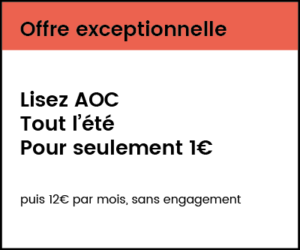
Il nous (les terriens) revient dès lors d’inventer de nouvelles manières de penser le monde et notre cohabitation tant à l’échelle globale qu’à l’échelle locale et de nouvelles façons d’y agir. Car la cohabitation (des humains entre eux et des humains et des non-humains) est bel et bien ce que l’anthropocène met sous tension. Nous prenons conscience que nous ne pourrons pas habiter sans coup férir à 10 milliards d’individus, en 2050, selon les standards de vie imposés comme un horizon insurpassable par des décennies de consumérisme prédateur des ressources.
La chose n’est pas simple à admettre ; plus encore les conséquences de cette affirmation élémentaire sont redoutables à affronter. Il importe pourtant d’appréhender différemment notre condition humaine et terrienne et à définir de nouvelles perspectives de vie en commun, qui ne nous fasse renoncer ni aux exigences de justice, ni aux acquis démocratiques, ni aux désirs d’assurer une existence digne à chacun.
Pour cela, il n’y a peut-être pas de chantier plus crucial que d’en revenir à un exercice fondamental : comment « imager » notre expérience habitante et son « milieu » ? Pour le comprendre, rappelons un fait : depuis le début de la période « moderne » occidentale, on (derrière ce on : les scientifiques, les institutions, les militaires, les voyageurs, les explorateurs, les artistes…) n’a eu de cesse de concevoir des im
