Le coup de force invisible d’Emmanuel Macron
Que se passe-t-il exactement dans ce pays ? À quelle réalité politique sommes-nous confrontés depuis plus d’un an ? Ce que nous traversons, et qui s’est aggravé au fil des mois, s’accélérant ces derniers jours, n’est pas seulement une crise institutionnelle inédite, mais une profonde crise d’interprétation : les différents acteurs sociaux — politiques, médiatiques, intellectuels — semblent en effet incapables de s’accorder sur une définition de la situation[1].
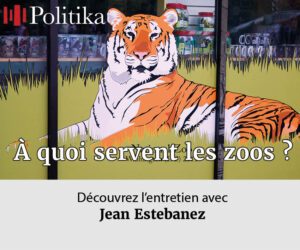
Depuis la dissolution surprise de l’Assemblée nationale en juin 2024, nous avançons sans mot partagé pour décrire la situation politique dans laquelle nous sommes pris. Ce vide interprétatif explique sans doute pourquoi, quatorze mois plus tard, le coup de force institutionnel d’Emmanuel Macron se poursuit sans qu’il soit désigné comme tel. Car il s’agit bien d’un coup de force, au sens politique du terme : un usage dévoyé mais juridiquement légal des prérogatives présidentielles pour contourner la logique parlementaire. La France vit sous un régime suspendu entre légalité et illégitimité, et l’absence de mots pour dire cette tension la rend d’autant plus durable.
Le coup de force institutionnel
Ne se contentant pas de s’appuyer sur des faits mais les articulant logiquement les uns aux autres, deux constitutionnalistes parmi les plus affutés et respectés, Denis Baranger et Olivier Beaud, ont très récemment analysé et proposé de caractériser la situation politique actuelle. Publiée en ligne seulement et clairement titrée « Emmanuel Macron ne peut plus et ne doit plus se comporter comme l’homme fort du régime », leur tribune dresse le constat précis d’un dérèglement majeur : depuis la dissolution de 2024, le président de la République s’obstine à gouverner sans majorité parlementaire, en nommant successivement Michel Barnier, François Bayrou puis Sébastien Lecornu (et de nouveau Sébastien Lecornu, doit-on ajouter depuis la parution de leur texte), tous incapables d’obtenir ou de maintenir la confiance
