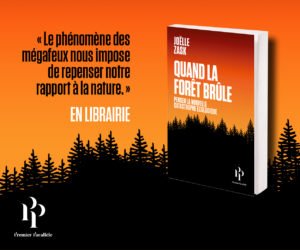La fiction et l’effondrement qui vient
Cette année, la notion d’effondrement a opéré une percée remarquable dans les médias. Avec elle s’impose comme une évidence un discours qui semblait, il y a encore quelques années, passablement délirant : celui de la fin prochaine de notre civilisation.
On peine à trouver des arguments à opposer aux prophètes de la collapsologie : tous semblent faibles et sonnent faux. Mais à chercher si vraiment on n’a plus d’autre perspective d’avenir qu’une catastrophe généralisée, on perd de vue que tout discours sur le futur est fiction. Qu’il se dise prévision, prospective, collapsologie, expérience de pensée ou prophétie, tout récit de l’avenir est d’abord une fiction, inscrite dans des débats présents, bâtie à partir d’une connaissance du présent et rendant compte d’un point de vue sur le présent. Ce qu’on peut découvrir dans un tel récit est moins ce qui nous arrivera demain que ce qu’on éprouve, espère ou craint aujourd’hui.
Tout cela est trivial. Mais on en tire rarement une conclusion pourtant obvie : à tout prendre, mieux vaut une fiction qui se présente comme fiction et qui ne propose d’illusion que consentie. On sait depuis Coleridge que le lecteur de romans suspend volontairement son incrédulité : il accorde sa créance à la fable qu’il lit pour en jouir, mais il ne la confond pas avec le monde dans lequel il vit. C’est cette distinction qui a permis à Joseph Conrad d’opposer le « penseur [qui] s’enfonce dans la région des idées » et parle ainsi à notre intelligence et – inévitablement – en même temps « à notre crédulité », et « l’artiste [qui] s’adresse au sentiment du mystère qui entoure nos vies, à notre sens de la pitié, […] au sentiment latent de solidarité avec toute la création ».
Le romancier ne demande pas qu’on croie à l’histoire qu’il raconte, mais qu’on en ressente des affects : c’est pourquoi, quand il s’agit du futur, mieux vaut sans doute lire des romans ou regarder des films qu’écouter des futurologues. Romans et films ne prétendent pas dévo