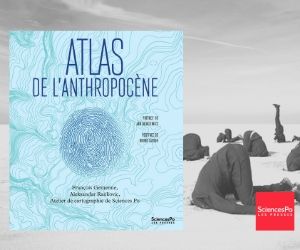Tunisie : joyeux cérémonial et triste bilan présidentiel
A quoi se mesure un bilan politique ? Comment le juger ? Doit-on, comme la presse tunisienne l’a fait de manière parfois caricaturale, célébrer le symbole, celui du président élu lors de la première élection au suffrage universel direct de l’histoire de la Tunisie, de l’homme à la tête d’un pays qui malgré toutes les embuches (économie déclinante et peu diversifiée, tourisme en berne, corruption, terrorisme, conflit libyen, enlisement régional…), est parvenu depuis huit ans à ne pas hypothéquer son destin démocratique ? N’est-il utile d’examiner avec attention les positionnements successifs d’un homme politique jamais très loin du pouvoir depuis l’indépendance en 1956, et la somme des rendez-vous manqués sous sa présidence ?
Il y avait quelque chose de désagréable, dans ces funérailles nationales qui étaient avant tout, certes, une manière pour les Tunisiens et le monde de célébrer leur pays, mais qui s’accompagnaient d’une chasse systématique au commentaire critique. Comme si le fait de ne pas honorer Béji Caïd Essebsi, président en exercice décédé le 25 juillet 2019 à l’âge de 92 ans, revenait à insulter la nation tunisienne. C’est pourtant tout le contraire : porté sur le devant de la scène dès le lendemain de la révolution sur proposition de plusieurs cadres de l’ancien régime pour tenter une synthèse entre la révolution et l’ordre ancien, « BCE » a davantage pesé sur le sort de la Tunisie post-révolutionnaire qu’aucun autre homme politique, hormis le dirigeant du parti Ennahda, Rached Ghannouchi.
Béji Caid Essebsi représentait cette personnalité d’un autre temps, à même de jeter un pont entre toutes les époques de la Tunisie indépendante.
Dans les faits, Beji Caïd Essebsi a concentré tous ses efforts pour limiter les effets de cette révolution sur son pays et le renouvellement de ses élites politico-économiques. Avec un certain succès : en dehors de la possibilité nouvelle pour les femmes tunisiennes d’épouser un non-musulman depuis septembre 2017, o