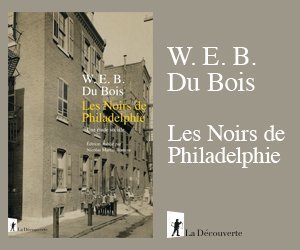Quand sonne le glas – sur Ordesa de Manuel Vilas
D’où vient que cela sonne juste ? Comment est-il possible qu’un livre sonne parfaitement juste, quand un autre, à côté, là, sonne faux du début à la fin ? Ça ne cessera jamais de m’étonner. Car au fond, les mots sont les mêmes, sans parler des histoires. Alors comment atteindre cette justesse de ton qui jamais ne faillit ? C’est la musique, bien sûr, qui nous montre le chemin. Je ne parle pas ici d’être bon, meilleur ou pire, il s’agit d’autre chose. Mozart, les Beatles ou Radiohead (pour donner les trois premiers exemples qui nous viennent) jamais ne sonnent faux ; qu’ils atteignent des sommets ou soient dans une petite forme dans ce concerto-ci, dans cette chanson-là, c’est autre chose, et à vrai dire ça ne compte pas. C’est donc une question de rythme, de tonalité, d’accords, une question de forme, de composition, de justesse d’exécution, c’est une question de voix. Ça ne semble rien, et c’est bien sûr la chose la plus difficile qui soit.
Ordesa, de Manuel Vilas (Editions du Sous-sol), sonne juste du début à la fin. Ce n’est peut-être pas un hasard si ses personnages finissent par être affublés des noms de Vivaldi, Brahms, Monteverdi ou Jean-Sébastien Bach. L’écrivain espagnol trouve son rythme et sa fréquence dans une ligne claire et épurée qu’il déroule de la première à la dernière phrase, et qui est celle de la confession, ou plutôt d’une voix crue, à vif, désespérée et drôle, relatant son existence, celle de ses parents, leurs morts et le vide qu’elles laissent en lui.
Un homme est assis à sa table dans une ville espagnole poussiéreuse et jaune (Zaragoza) dans un appartement sans meubles, sans personne. Il pleure la mort de ses parents (enfin, il ne pleure pas, il n’a plus rien dedans.) Ses enfants ne rentrent pas. Il est seul dans l’existence, dans sa chair, dans sa lignée biologique. Cet homme c’est Manuel Vilas, brillant écrivain espagnol que l’on lit depuis quelques années, et il va tout nous raconter.
Chaque court chapitre, ou fragment, rond e