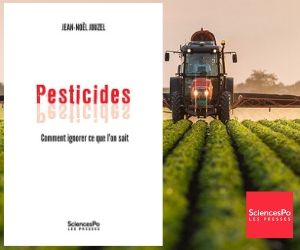Sahel : l’incohérence des zones sécuritaires
La plupart des Françaises et Français ont récemment découvert ce que les zones orange et rouges voulaient dire pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). En mai 2019, les médias ont longuement évoqué l’enlèvement de deux touristes français dans le Nord du Bénin et l’assassinat de leur guide béninois. À l’époque, il a régné une certaine confusion sur le fait que la zone où s’étaient rendues ces trois personnes était interdite, ou pas, selon les consignes du MEAE.
Les journalistes ont notamment affirmé que « La zone de Pendjari avait récemment été classée parmi les zones “formellement déconseillées” par le Quai d’Orsay ». Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères avait même entretenu la confusion en affirmant dans un premier temps que la zone était rouge. Si un ministre de la République, spécialiste de ces questions, est un peu perdu dans les couleurs, imaginez le reste de ses concitoyen·es.
Les Françaises et Français viennent d’apprendre la semaine dernière qu’un second chercheur était détenu en Iran depuis trois mois. Les autorités françaises avaient décidé de ne pas en parler, alors qu’en juillet 2019, les médias ont évoqué l’anthropologue chercheure franco-iranienne retenue aussi en Iran, montrant ainsi que les scientifiques sont aussi, de par leurs objets de recherche, confrontés à ces enjeux de sécurité et d’accès à leur terrain.
Mais ces scientifiques ne sont pas des touristes qui prennent des risques. Ils ont décidé de consacrer leur carrière (et leur vie) à comprendre des phénomènes et produire des connaissances scientifiques sur des objets qui parfois se trouvent, ou se retrouvent par le biais de l’histoire contemporaine, dans des zones difficiles d’accès. Lorsque ces scientifiques sont des fonctionnaires de l’État français, ils sont payés par les contribuables et leurs recherches sont la majeure partie du temps financées par des fonds, eux aussi, publics. Ces travaux devraient normalement nourrir les débats pub