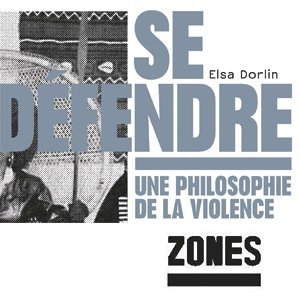Carnaval noir contre black faces
Depuis cinquante ans, le carnaval de Dunkerque – qui se tient pendant les trois jours intenses du dimanche, lundi et mardi gras, mais aussi s’étale du 6 janvier au 8 avril en de nombreuses soirées masquées à thème – réserve une soirée spéciale, celle du 10 mars, à la « Nuit des Noirs ». Les caricatures outrancières ont été légitimement dénoncées par le leader du CRAN comme s’inscrivant dans un racisme esclavagiste et colonial, comme on a pu le dire aussi du personnage de Pierre le Noir au carnaval d’Amsterdam mais tout autant, dans différents carnavals européens et latino-américains, des masques et déguisements de « Juifs », de « Tsiganes », de « Maures », de « Turcs », de « Negritos » et autres figures de l’étranger et du sauvage. De son côté, le maire de la ville en appelle à la liberté carnavalesque et au « droit de changer de peau » pendant ce temps à part. Sans chercher à minimiser la polémique, il peut être intéressant au contraire de l’approfondir, et de se demander de quel monde – ou quels mondes au pluriel – le carnaval est le lieu, à qui il appartient, et comment chacun s’approprie et transforme cet espace.
La culture populaire est « polémologique » et « utopique », écrivait l’historien Michel de Certeau dans L’invention du quotidien (1980). C’est une bonne grille de lecture pour nous aider à penser le carnaval, celui de Dunkerque et sa polémique autour de la prochaine « Nuit des Noirs », comme le carnaval en général et ses infinies variantes dans le monde. Il est un espace polémologique au sens où il se nourrit de la critique sociale et ne cesse, en retour, de nourrir les polémiques. C’est cette propriété-là qui le rend populaire, voire « petit » ou « sale » comme on le nomme parfois, très lié aux quartiers et aux villes où il naît, qui se lancent des défis, esthétisent et surtout ritualisent leurs différences et leurs différends en les déplaçant du monde social quotidien vers des formes et cadres esthétiques, des fictions ou des rêves. Il est