Force à la loi – sur Les Misérables de Ladj Ly
Qui s’est intéressé aux bavures policières dans les cités sera peut-être surpris de ne pas assister au brûlot politique qu’il attendait. Qui a lu Le combat Adama signé Assa Traoré et Geoffroy de Lagasnerie également. En fait de critique frontale et radicale de la police, le film brosse un portrait autrement nuancé des rapports entre celle-ci et les jeunes banlieusards.
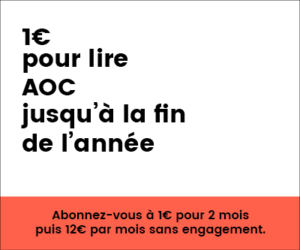
Comment décrire l’état de nerf dans lequel nous conduit ce film, sa puissance sensorielle ? Il nous laisse à la fois hagards et électrisés, foudroyés et désemparés. En dépit de ses défauts, irrésistiblement il nous travaille. Car sa force de frappe est torrentielle. Car il débouche sur un constat alarmant, qui entérine sinon décuple par la puissance de la fiction et des moyens cinématographiques nos craintes les plus abyssales quant au devenir de la France, à la possibilité qui semble s’effriter du vivre-ensemble entre divers groupes sociaux.
Dans la banlieue de Montfermeil, des gitans d’un cirque itinérant ont perdu Johny, leur lionceau. Ils menacent de mettre le feu aux poudres si les jeunes de banlieue, qu’ils accusent, ne le leur rendent pas au plus vite. L’équipe de la BAC s’empresse alors de retrouver l’animal, mais s’ils retrouvent l’identité du coupable, Issa, l’opération se déroule mal. L’un des policiers commet une bavure en touchant le gamin d’une balle de flash-ball. Le récit est presque réglé sur une unité de temps : il s’étire sur un peu plus de vingt-quatre heures seulement.
La première séquence du film est aussi réjouissante que la dernière est terrifiante. Cet écho antinomique est d’une redoutable efficacité. Toutes deux portées par une agitation et une effervescence toutes particulières, elles informent le fossé social qui grève notre société, entre policiers et banlieusards, dominants et dominés, puissants et misérables.
Le film commence par une scène de liesse consécutive à la victoire de l’équipe de France de football à la coupe du monde 2019. Mais ces images de « joie sans mélan
