Hong Kong : la cité contre l’empire
Si l’histoire politique européenne peut être examinée sous l’angle de la « cité » ou de l’« empire », puis de l’« État-nation », l’histoire politique de la Chine, on le sait, est avant tout l’histoire d’un empire. Certains historiens, tel le grand savant japonais Ichisada Miyazaki (1901-1995), pensent que la Chine a connu dans son histoire une période de « cités » avant son unification sous l’empire. Nous pourrions approuver sa thèse d’un point de vue historique, mais peu d’éléments montrent que la cité chinoise antique développa un esprit de liberté du même genre que les cités européennes anciennes telles Athènes, Rome, Venise… de l’antiquité jusqu’à l’aube de l’époque moderne.
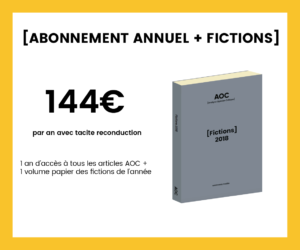
C’est un fait historique. Même si les empires sont des formes alternatives qui se substituent à la cité et ont dominé pendant une longue période en Europe, cette âme de liberté propre aux cités persiste et survit. On constate sa nouvelle incarnation institutionnelle moderne dans les États-nations démocratiques.
Du côté de la Chine impériale, la question politique se centrait pourtant sur deux questions : comment réguler les rapports entre le pouvoir central et le pouvoir local, et de quelle manière mieux administrer les sujets de l’empire. Les institutions impériales favorisèrent la paix et la prospérité qui en résultait, mais furent aussi à l’origine du chaos cyclique des dynasties et entravèrent le développement d’une société civile au sens moderne.
Cela à cause d’une rigidité et d’une centralité excessives, une inertie face aux changements, surtout dans les phases de déclin des dynasties. Même s’il existait de nombreuses villes dans l’histoire ancienne de la Chine, parfois très prospères et puissantes, elles n’ont jamais gagné l’indépendance dont les cités européennes disposaient. Elles restaient toujours sous la tutelle plus ou moins directe du pouvoir impérial.
Hong Kong est née avec la modernité, en fait partie, et témoigne du processus de la construction de la modernité chinoise dan
