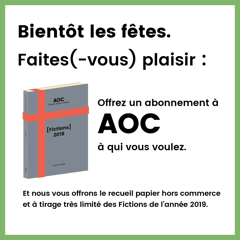Inégalités économiques et changement climatique
En France, une vision assez répandue dans le grand public est que la mondialisation des économies a généré un creusement tous azimuts des inégalités. On assimile mondialisation et inégalités croissantes et, par réciprocité, démondialisation et réduction des inégalités. La mondialisation devient un bouc émissaire facile à incriminer. Cette représentation alimente la vague populiste.
Le seul problème est qu’elle ne concorde pas avec la réalité. La mondialisation a provoqué un double mouvement sur les inégalités dans le monde. Depuis un demi-siècle, elle a drastiquement réduit les écarts entre niveaux de vie des pays en y réduisant la pauvreté quand elle creusait des inégalités à l’intérieur de la plupart des pays.
Pierre-Noël Giraud est l’un des premiers économistes à avoir analysé ce double phénomène dans son Inégalité du monde paru en 1996. Il y distingue une première phase historique dans laquelle les inégalités de niveau de vie se sont dramatiquement accrues entre pays occidentaux et Japon d’un côté, et le reste du monde « en développement » de l’autre. Ces tendances s’inversent à partir des années 1980 du fait du puissant reflux au profit des grands perdants d’hier.
Dans le même temps, les inégalités qui tendaient à se refermer au sein des pays riches ont recommencé à se creuser. Les travaux de François Bourguignon et Christian Morrisson, parus dans les meilleures revues académiques, corroborent ce diagnostic.
Sous l’angle des émissions de gaz à effet de serre, ce mouvement de flux-reflux de la création de richesse correspond rigoureusement aux dynamiques d’émission observées dans le monde. La croissance des émissions mondiales de CO2 est portée à peu près exclusivement par les pays d’industrialisation ancienne jusqu’aux chocs pétroliers de 1973 et 1980, la plus grande partie du monde restant à des niveaux d’émission par tête extrêmement bas.
Si on redistribue du pouvoir d’achat du haut vers le bas, on accroît donc mécaniquement les émissions.
Le creusement des