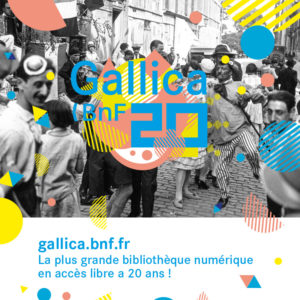Pour un droit de copier son voisin
La jalousie peut parfois être source d’innovation. C’est par exemple en jalousant les imprimeurs que les écrivains ont eu l’idée de réclamer des droits d’auteur. Aujourd’hui, c’est au tour des éditeurs de presse de revendiquer de mystérieux « droits voisins », ces droits qui ressembleraient à des droits d’auteur mais qui n’en seraient pas.
Avant le XVe siècle, il ne venait à l’esprit de personne de revendiquer des droits sur des textes littéraires. Avec l’arrivée de l’imprimerie, pouvoir autoriser ou non la publication d’un texte est devenu un enjeu économique majeur. Les imprimeurs ont été les premiers à réclamer un monopole sur la reproduction des textes qu’ils diffusaient. Ce privilège leur a été accordé pour soutenir leurs investissements. Trois siècles plus tard, les auteurs se sont inspirés de cette idée pour obtenir des droits économiques sur leurs textes. Au XIXe siècle, ils ont obtenu, en plus, un « droit moral » (qui contient notamment le « droit de paternité », c’est-à-dire celui d’être cité).
Au tournant du XXe siècle, l’arrivée des nouvelles technologies va générer de nouvelles jalousies. Avec l’apparition de la radio, les chanteurs constatent une baisse de fréquentation de leurs spectacles. On ne va plus les voir « en chair et en os » : on les écoute à distance avec ces nouveaux moyens de diffusion. Or, ils ne sont pas considérés comme des auteurs mais comme de simples interprètes : ils ne perçoivent donc rien lorsqu’ils ne sont pas sur scène. Par « jalousie créative », ils vont s’inspirer des auteurs pour revendiquer à leur tour un droit immatériel : le « droit voisin », qui contiendra, comme le droit d’auteur, des avantages financiers et symboliques. L’idée est séduisante. Elle l’est tellement qu’elle inspire dans les années 60 les « producteurs de phonogrammes » (les créateurs de disques) : à la recherche d’argent frais, ils réclament eux aussi des « droits voisins » en plaidant que leurs investissements constituent un atout pour l’ense