Le syndrome « Pinocchio »
Il y a quelques jours, à la télévision, le père de Boris Johnson, l’actuel premier ministre britannique, allant par le nom de Stanley Johnson, lui-même ancien député conservateur, réagit vivement à la lecture qu’on lui faisait d’un tweet où son fils était comparé à Pinocchio. La réaction de Stanley Johnson ne se fit pas attendre, il persifla, afin de marquer le rejet de cette opinion comme absolument nulle et non avenue. Il railla, il dit avec morgue que le grand public britannique ne savait probablement même pas écrire le nom Pinocchio. Il apostropha même l’animatrice de l’émission : « Et vous, vous savez orthographier Pinocchio ? Essayez, essayez donc. »
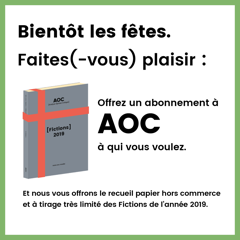
Cette méthode pour disqualifier le propos de l’adversaire, bien connue des discoureurs sans scrupules, est l’argument ad personam, l’« ultime stratagème » comme le caractérise Arthur Schopenhauer dans son incisif « manuel », L’Art d’avoir toujours raison : « L’attaque personnelle consiste à se détourner de l’objet du débat, pour s’en prendre à la personne du débatteur »[1]. Pourquoi Stanley Johnson devient-il à dessein vexant, blessant, grossier ? Pourquoi passe-t-il au registre de l’invective sans réfléchir ? Car il réagit d’instinct. Il y a en effet quelque chose de vital qui se joue là, comme l’a bien vu Schopenhauer : « Les facultés de l’esprit passent le relais à celles du corps, à notre côté animal ».
Cette attaque ad personam signale l’abandon soudain de toute éthique de la discussion. Le régime cognitif qui s’enclenchait-là, sur ce plateau de télévision, était donc infra-rationnel. Schopenhauer développe cette idée, non sans ironie : « Cette règle est fort populaire, car à la portée de tous, et se trouve ainsi souvent mise à contribution. Reste à savoir quelle parade s’offre à l’autre partie. En effet, en soignant le mal par le mal, le débat ne tarderait guère à tourner au pugilat, au duel ou au procès pour outrage. »
Or qu’est-ce qui provoqua cette rhétorique visant délibérément à outrager le public ? Ce
