La Convention citoyenne pour le climat : innovation démocratique ou régression juridique ?
Du 4 octobre 2019 au 4 avril 2020, 150 citoyens et de nombreux experts se réunissent régulièrement au Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour répondre à la question ainsi formulée par Premier ministre dans une lettre datée du 2 juillet 2019 : « définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030 par rapport à 1990 ».
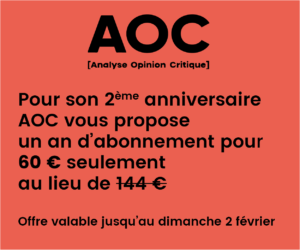
Notre propos est le suivant : la Convention citoyenne pour le climat ne peut constituer « une innovation démocratique » qu’à la condition de se départir d’un certain nombre de malentendus dont elle est actuellement affectée et que le présent article propose de lister. À défaut, elle créera, sur bien des points, un risque de régression du droit de l’environnement. Pour une raison principale : elle ne respecte actuellement pas les exigences du principe de participation du public inscrit dans la Charte de l’environnement qui a pourtant valeur constitutionnelle.
Avant toute chose, précisons qu’il doit être possible de reconnaître la sincérité, le sérieux et l’investissement des personnes – citoyens et experts – qui composent la convention citoyenne tout en interrogeant le cadre – ou plutôt l’absence de cadre – dans lequel ils travaillent. Précisons aussi qu’interroger ce cadre est un impératif pour que la démocratie participative soit prise au sérieux et, ainsi, devienne un complément utile de la démocratie représentative. Notre propos n’est donc pas de condamner mais d’interroger.
La promesse de la question ouverte
La Convention citoyenne repose tout d’abord sur une promesse de liberté : celle qui serait conférée aux 150 citoyens pour réfléchir à l’abri des pressions et des influences extérieures. Reste que ces 150 citoyens sont chargés de répondre à une question formulée par le seul premier ministre et dont le contenu encadre et limite d’ores et déjà leur liberté et leurs travaux. La question, comme souvent, n’est pas si ouverte.
Prem
