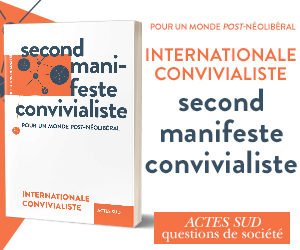Texaco, Liberdade, et l’En-ville Faire ville, faire communauté (2/3)
Au début des années 1990, je vivais à Salvador de Bahia au Brésil, où j’avais décidé d’aller habiter quelques années plus tôt dans le quartier Liberdade sur lequel je menais une recherche urbaine et anthropologique. J’y ai étudié le racisme, la pauvreté et la mobilité sociale, le mouvement noir et l’histoire du carnaval afro. A ce moment-là, un fort mouvement autour de la fierté noire et du mouvement culturel afro redonnait une vigueur et une notoriété inédite à ce quartier dont les premières ruelles avaient été ouvertes à la fin des années quarante par des migrants venus du Recôncavo, la vaste région entourant Salvador.
A Liberdade, j’ai découvert la vie des mornes et le labyrinthe des ruelles, impasses et venelles. J’ai rencontré une vieille dame Maria « des cendres » (das cinzas), dont la vie est un roman, me disait-elle, et la famille une honte. Elle n’avait plus d’âge. Sa peau n’avait plus de couleur, elle était cendre, grise, comme ses habits, toujours la même jupe et le même chemisier, qui n’avaient plus que la teinte du coton tissé. Et c’est là à Liberdade, que j’ai découvert Texaco ! Ou plus précisément c’est de là que j’ai vu Marie-Sophie Laborieux fonder le quartier Texaco à Fort-de-France, tel que raconté par Patrick Chamoiseau dans son roman intitulé justement Texaco, prix Goncourt en 1992. J’ai lu le livre les yeux écarquillés, fasciné et enchanté par tant de résonance.
D’abord il y eut la ressemblance entre les histoires brésilienne et antillaise : l’esclavage, aboli juste un siècle plus tôt au Brésil, un siècle et demi en Martinique ; la dimension raciale des identités et des relations dans une société donc multiraciale ; le pragmatisme, le fatalisme et la force des esprits dans la culture populaire noire urbaine née dans l’esclavage et poursuivie dans la société post-esclavagiste ; la « douce langueur » aux Antilles comme la saudade au Brésil ; les zombis et les esprits là-bas, et ici, à Bahia, le Preto Velho (le vieux Noir, esprit de la