Les droits importuns de la citoyenne Mila
Le 18 janvier 2020, dans une petite ville de la province française, une lycéenne de 16 ans est menacée de mort sur Instagram pour avoir fait usage de son droit constitutionnel à la liberté d’expression. L’un de ses interlocuteurs n’a pas supporté qu’elle exprime un rejet catégorique des religions en général et de l’islam en particulier ; ses amis dûment alertés, il a formé une coalition, bientôt répandue dans plusieurs réseaux sociaux. Elle est si nombreuse et agressive que la jeune Mila doit se mettre sous la protection de la police, et qu’elle est contrainte d’entrer dans la clandestinité : en quelques heures, son droit d’aller et de venir, son droit à l’éducation, son droit à l’intégrité corporelle, et son droit à la vie sont ainsi anéantis.
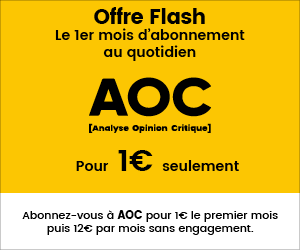
Les médias tardent à rendre compte de ce fait divers d’un genre nouveau, certains d’entre eux refusant même d’en parler après que « l’affaire Mila » se soit installée à la Une. Le gouvernement, la justice, les personnalités politiques et les intellectuels publics, quand ils ne se réfugient pas dans le silence, se demandent pendant quelques jours lequel des deux partenaires de ce malheureux live sur Instagram doit porter la responsabilité d’une situation aussi désastreuse.
D’ailleurs, comment convient-il de la qualifier ? Faut-il l’envisager sous l’angle du droit, de la coexistence civile, ou de la morale ? Quant à l’opinion commune, elle paraît balancer entre la disqualification de l’événement — une dispute entre des adolescents mal élevés —, et la crainte de la violence attribuée aux « musulmans ». Plus encore que les malheurs de la jeune Mila, l’embarras considérable de si nombreux Français majeurs paraît donc caractériser cet événement, et en faire un emblème de notre état de société en 2020.
Deux médias ont publié tout ce qu’on peut savoir de l’épisode initial de cette crise, puisqu’ils ont été les seuls à enregistrer un entretien avec Mila avant qu’elle n’entre dans la clandestinité. Ils ont paru les 21 et 22 janvier, e
