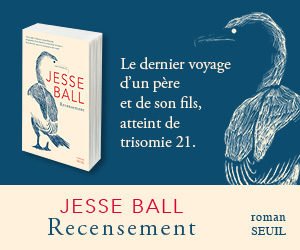Vivre plus loin – à propos de Croire aux fauves de Nastassja Martin
Une femme, un ours. Un face-à-face improbable au sommet du Klioutchevskoï, le plus haut volcan du Kamtchatka, en Sibérie. Dans un conte russe, l’issue de la rencontre serait terrible ; dans la vraie vie, c’est une déflagration. L’ours se rue sur la femme qui, l’espace d’un instant, pense – je vais mourir là, dans la gueule de l’ours, dans cette odeur épouvantable – et lui croque le visage. Elle saisit son piolet et frappe à l’aveugle. L’ours blessé la lâche et s’enfuit. Que s’est-il passé ?
« Moi et l’ours, mes mains dans ses poils et ses dents sur ma peau, c’est une initiation mutuelle : une négociation au sujet du monde dans lequel nous allons vivre. »
Croire aux fauves est l’histoire de cette initiation. Nous l’accompagnons à l’aveuglette, en suivant le récit de Nastassja Martin du « basculement de sa vie » à ses conséquences. Médicales, anthropologiques, existentielles, éthiques et littéraires : celles-ci n’en finissent plus de déployer leurs ramifications devant une narratrice qui oscille entre stupeur, rage de vivre et désir inextinguible de « comprendre plus loin ».
Nastassja Martin est anthropologue. Son métier la fait s’immerger dans un « terrain » qu’elle a choisi, généralement au sein de communautés qui se sont volontairement retranchées de la société moderne, afin d’en comprendre les règles et les principes et d’en rapporter, sous une forme synthétique et scientifique, une description éclairante pour les esprits occidentaux. La démarche, qui s’inscrit dans les pas de Claude Levi-Strauss et de Philippe Descola, son ancien professeur, dit déjà quelque chose de l’empathie et de l’ouverture à des mondes autres qui sont les nécessités de son métier.
A vingt et quelques années, elle a vécu en Alaska, parmi la communauté des gwich’in ; plus tard, c’est de l’autre côté du détroit de Bering, au Kamtchatka, au fin fond de l’extrême Orient russe, qu’elle pose ses valises d’anthropologue. Elle y partage la vie des Evènes, une communauté qui a choisi, aprè