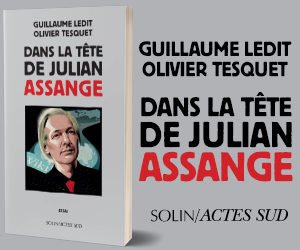En Italie, naissance (et extinction ?) des Sardines
L’activité politique de l’Italie se résume aujourd’hui, comme dans le reste du monde, à l’organisation collective de la lutte contre les affres de la contamination. Oubliée donc pour l’instant la campagne électorale pour les six élections régionales qui devraient normalement se tenir le 31 mai prochain. Or, ce scrutin se présentait déjà comme une nouvelle épreuve de force que le leadeur des droites extrêmes, Matteo Salvini, voulait engager dans sa croisade pour faire chuter le gouvernement et forcer un retour aux urnes. Une sorte de revanche après l’échec qu’il a subi lors de l’élection régionale de janvier dernier en Emilie-Romagne qu’il avait délibérément transformé en un plébiscite sur sa personne et qui s’est soldé par un échec.
Au terme d’une campagne particulièrement âpre, le représentant du Partito Democratico (PD), parti social-démocrate discrédité et rejeté, l’a emporté avec 51% des voix contre 43 à la candidate de la Lega. Depuis, Salvini ronge son frein, en convoitant cette fois de gagner la Toscane, bastion historique de la gauche. Et puisque la vie politique institutionnelle va reprendre une fois l’épidémie résorbée, il vaut encore la peine de revenir sur les leçons qui ont été tirées de l’élection en Emilie-Romagne.
La première de ces leçons s’est lue dans l’empressement que des analystes ont mis à affirmer que la ligne de partage traditionnelle que trace l’affrontement droite/gauche a été rétablie. Cette proclamation exprimait le soulagement de voir se refermer la parenthèse gênante de l’irruption inopinée des novices du Movimento Cinque Stelle (M5S) dans les milieux considérés comme réservés aux professionnel·le·s de la politique. L’annonce enjouée de ce retour à la normale de la démocratie représentative passait deux faits par pertes et profits. Le premier est que le M5S détient toujours la majorité des sièges au Parlement ; et le second est l’acte politique qui a marqué cette élection : l’occupation des places des villes italiennes par