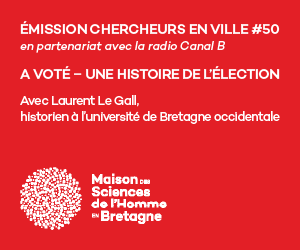Coronavirus, un mal pour un bien ?
Nous sommes en 2020, une épidémie venue de Chine envahit l’Europe du nom de Coronavirus. L’inquiétude est palpable, bien que tous n’aient pas lu la Peste à Athènes de Thucydide, l’épidémie raisonne comme un mal absolu, une fatalité qui laisse l’homme impuissant lorsqu’il n’est pas en mesure de la contrer.
Ce virus fait resurgir la mémoire des épidémies, celle rapportée par Thucydide mais aussi par Camus dans son livre fameux la Peste qui toutes deux ont marqué notre imaginaire social. Venise récemment, vient d’être mise en quarantaine, cette mise au ban de la Sérénissime a une forte puissance d’évocation. Nous avions oublié le sens du mot épidémie et de son superlatif, la pandémie, croyant à notre exceptionnalité humaine pour la neutraliser et l’endiguer. Et soudain nous découvrons sa résurgence qui nous sidère et qui occupe toutes nos conversations.
Le Coronavirus dans l’espace public prend la place du réchauffement climatique. Dans les médias des prophètes de l’effondrement paradoxalement se font moins entendre. Ils n’ont plus à avertir de l’imminence de la catastrophe, « la tempête microbienne » (Patrick Zylberman) est là qui met à mal nos repères, nos habitudes et nos modes de vie. Un brin d’apocalypse s’empare du monde, il nous faut nous préparer à une menace qui n’est plus celle du terrorisme mais d’une guerre contre un risque sanitaire dont l’échelle planétaire met en question l’idée même de souveraineté nationale.
La hantise de l’apocalypse mine les fondements du néo-libéralisme et de son économie mondialisée. Le risque épidémique rend visible les faiblesses du système de santé propre à chaque pays, le futur devient de plus en plus incertain et la décision soumise aux aléas n’est pas en mesure de prévoir les conséquences tant sanitaires que sociales, économiques et politiques. L’État est sur le pied de guerre, il mobilise l’ensemble de ses services et appelle à une approche intégrée qui sache s’affranchir des frontières traditionnelles entre serv