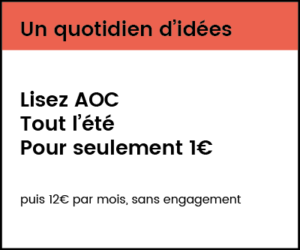Nous sommes en care
Bien avant l’apparition de l’épidémie mondiale de Covid-19, les sciences de l’environnement et les sciences sociales avaient commencé à prendre ce que l’on peut appeler le « tournant anthropocène », c’est-à-dire la manière de prendre acte que c’est dorénavant de l’action ou l’inaction humaine que dépend la survie de l’humanité, partie prenante d’un environnement devenu moins hostile que fragile.
Cette formulation permet d’évoquer le moment historique où nous nous trouvons, celui d’une seconde modernité où les conséquences contemporaines de la première modernité étendent nos interdépendances et questionnent les solidarités héritées de la modernité tout autant qu’elles appellent d’autres formes possibles de solidarité.
Depuis longtemps déjà, penser sortir des impasses occidentalocentrique, patriarcale, capitaliste, extractiviste et positiviste de la modernité en parlant de « postmodernité » n’avait plus de sens. Le monde n’est pas libéré de l’hégémonie et des réductions de la modernité : il apparaît au contraire de plus en plus globalisé dans ses interdépendances, ses rapports de pouvoir et ses vulnérabilités, conséquence des développements mêmes de la modernité.
C’est justement parce qu’il est impossible de rompre avec les conséquences de la modernité qu’est né le concept de « seconde modernité » proposé par Ulrich Beck et Antony Giddens. Tandis que la première modernité se pensait comme un « progrès » à la conquête guerrière de l’espace, du temps et de la nature, la seconde modernité est définie par sa double réflexivité.
Réflexivité mécanique, tout d’abord. Il n’y a plus « d’extérieur » à conquérir ni vers où transférer les risques, l’extension des interdépendances fait que dorénavant tout nous revient. Il n’y a plus de « futur » vers lequel tendre nos efforts, mais un « à venir » potentiellement catastrophique qui risque de se précipiter d’autant plus vite vers nous (par « effet papillon » ou « effet boomerang ») en fonction des actions du passé et du p