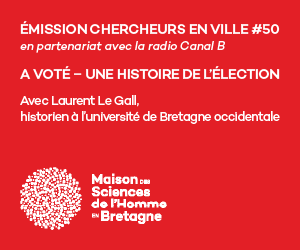Peut-on penser le post-coronalisme ?
Avant de poser cette question, il est nécessaire de s’attarder quelque peu sur l’épidémie elle-même, son origine supposée, sa diffusion et les représentations contradictoires auxquelles elle a donné et donne lieu, notamment sur le plan de la gouvernementalité de cette crise sanitaire. Le point de vue développé ici ne portera pas sur la médecine, pour laquelle je n’ai aucune compétence, mais plutôt sur la philosophie politique et l’anthropologie.
Une chose frappe tout d’abord, c’est l’exotisation de cette épidémie par les gouvernements, les médias et les opinions publiques des pays européens, exotisation qui explique sans doute en partie que ces gouvernements, en particulier italien et français, aient été pris de court.
Venant de Chine, l’épidémie de Covid-19 pouvait sembler lointaine et incapable de toucher l’Europe à l’instar du SRAS qui, en 2002-2003 n’avait affecté pour l’essentiel que la Chine et Hong-Kong, ou d’Ebola qui a frappé de larges régions d’Afrique en 2014. Cette fois-ci devant l’ampleur du phénomène et le fait qu’il se soit étendu à d’autres pays d’Asie (Corée du Sud, Taïwan) ainsi qu’à l’Europe et au reste du monde, on a pu observer que l’exotisation avait pris, dans une seconde phase, une autre forme.
Le virus se rapprochant, il n’était plus question de le considérer comme un phénomène lointain et relevant de la médecine tropicale mais de porter un jugement sur les méthodes autoritaires et efficaces qui ont été utilisées à des degrés divers par ces pays pour combattre cette crise sanitaire mais qui n’ont pas été jugées transposables par nos gouvernements et nos autorités médicales en raison de l’existence de « traditions culturelles » différentes. Ainsi ont été notamment mises en exergue par les différentes instances politiques, médicales et médiatiques, la supposée tradition d’obéissance des Asiatiques ainsi que leur habitude de porter des masques en cas de pollution ou d’épidémie.
Les Français étant, par contraste, jugés individualistes