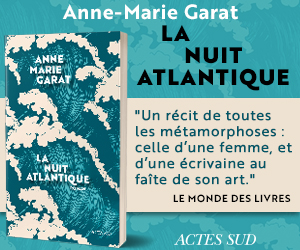Entre littérature et histoire – sur Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan de Romain Bertrand
Un numéro des Annales a rallumé il y a dix ans le débat ancien sur les conflits de territoire, intenses, houleux parfois, entre littérature et histoire. Ce débat n’a fait que s’intensifier depuis l’essai d’Ivan Jablonka qui proposait de considérer l’histoire comme une littérature contemporaine. Patrick Boucheron, Judith Lyon-Caen, Philippe Artières, Arlette Farge ou Sylvain Venayre, chacun à sa manière réarticule l’exigence méthodologique de l’histoire et le souci littéraire, pour solliciter dans la littérature une puissance d’inquiétude et une extension des expérimentations historiographiques possibles. C’est dans ce contexte que je voudrais replacer le récent livre de Romain Bertrand, Qui a fait le tour de quoi ? L’Affaire Magellan.
Bien sûr, libre à chacun d’inscrire ce récit dans le prolongement de ses précédentes propositions historiographiques, c’est-à-dire de choisir de réassigner le récit au champ méthodologique de l’histoire, mais porté par un désir pédagogique et une exigence de belle langue. Le lecteur y retrouvera quelques-unes des hypothèses méthodologiques développées dans ces dernières années. Une pratique de la narration dédoublée, théorisée dans L’Histoire à parts égales, qui permet de saisir le voyage de Magellan en multipliant les contrepoints et les perspectives, pour donner une égale dignité narrative au nom illustre et aux vies minuscules, une importance semblable aux récits des marins sous le commandement de Magellan et aux peuples qu’il croise. Au point de délaisser le temps de quelques pages la figure de Magellan pour instituer l’esclave Enrique comme le premier à avoir accompli le tour du monde.
Une pratique résolue de l’anachronisme qui nous fait découvrir à partir d’un texte de 1900 ce que les chroniques d’alors auraient pu dire des Punan. Une histoire connectée, qui montre avec vigueur et ironie que la mondialisation n’a pas attendu « les grandes explorations » : « les indices d’un monde déjà connecté au reste du monde sont pa