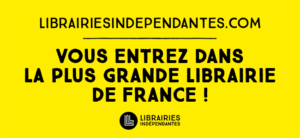La pandémie, la survie et l’impossible État européen
Toute crise aiguë a pour effet une suspension des routines. La crise pandémique que nous vivons a ceci de caractéristique qu’elle les suspend de manière relativement organisée, maîtrisée, cela probablement tant qu’une crise économique ou politique ne vienne s’y additionner. Paradoxalement, ce que la pandémie révèle est la force de l’État alors que sa faiblesse croissante, voire son dépérissement sous les coups de boutoir du néolibéralisme, a été sans cesse annoncée. À cette occasion, l’État ne surgit pas seulement dans sa dimension répressive, dans sa capacité de contraindre le confinement, d’infléchir nos conduites les plus habituelles. Il surgit, indissociablement, dans sa dimension providentielle.
Dans sa socio-genèse comparée de l’État-providence, Abram de Swaan a magistralement montré combien les épidémies ont toujours fortement contribué aux formes de solidarités institutionnalisées[1]. Dans la ville médiévale, les riches ne survivent pas s’ils ne se soucient aussi de la condition sanitaire des pauvres, de sorte que le financement des égouts, partout dans la ville, se pense comme une contribution au bien commun. Révélatrices des interdépendances sociales, les épidémies justifièrent et stimulèrent le développement d’une bureaucratie d’État capable de prendre en charge le sort des plus démunis. La précarité sanitaire, la pauvreté, et autres « fléaux » sont ainsi progressivement saisis comme des problèmes publics.
Ils font l’objet d’une progressive collectivisation — affermissant un État, toujours davantage bureaucratisé et ramifié. Des infrastructures urbaines à la sécurité sociale, de l’éducation de masse à la lutte contre la misère sociale, ses fonctions ne cessent de croître. Si l’on suit cette logique, retracée par A. de Swaan, on ne s’étonnera pas de voir aujourd’hui, au milieu d’une pandémie, dans un contexte de libéralisme économique pourtant triomphant, ressurgir le terme « nationalisation », mot que l’on pensait appartenir à une époque révolu