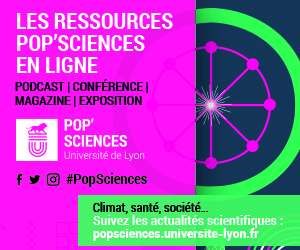Au-delà des dates souveraines, sur le 11 mai et après
Si l’on se demande pourquoi le Président de la République a choisi de fixer au 11 mai le début du déconfinement, la première réponse est sans doute qu’il fallait trouver en mai une date non-significative : une date qui ne puisse renvoyer immédiatement à une autre et qui donc pouvait se répéter (douze fois, surtout pas onze) en se référant uniquement à elle-même. Ce ne pouvait donc être pendant l’un des ponts de mai, non seulement parce qu’ils risquaient d’être des jours de départ, mais aussi parce qu’ils sont des jours de fête et de commémoration dépourvus de neutralité ; ni sans doute le 12, jour où Napoléon Bonaparte devint consul à vie… Le 11 était donc disponible.
Bien loin de la conviction d’un Trump ayant assuré que le coronavirus allait disparaître des États-Unis pour la fête de Pâques, la disponibilité de la date (toujours relative, le premier Printemps a ouvert un 11 mai sur les Grands Boulevards…), en la dégageant de la religion comme de l’histoire, la rapprochait de la science, dont l’objectivité n’a que faire des décrets souverains ou divins, comme des anniversaires de l’humanité – et cela même si ce rapprochement exigeait le choix souverain et non scientifique d’un « non-anniversaire ».
Il n’en reste pas moins que ce que nous savons de l’épidémie, comme des comportements à adopter vis-à-vis d’elle, porterait bien plutôt vers un retrait de toute date précise. La science elle-même nous présente une réalité dégagée autant que possible et de plus en plus de la religion et de la politique, et par là même de tout « jour j », voire de tout « instant t » : la physique quantique, la médecine, comme l’économie, s’accordent à considérer que la date d’un événement n’est que probable, statistique, foncièrement indéterminée – qu’il s’agisse de prévoir cet événement ou de savoir quand il a eu lieu. C’est la même chose en Histoire, pour peu que l’on considère que la Révolution française ne commence pas vraiment le 14 juillet 1789, de même qu’il y a plusie