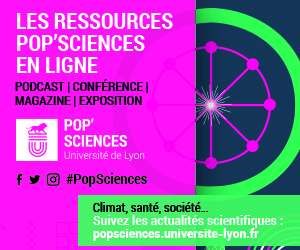Au revoir Monsieur Dame – à propos de Michel Piccoli
Un fond de pantalon souillé, un pet sonore aussi interminable qu’un râle d’agonie, Marcelo Mastroianni, Ugo Tognazzi et Philippe Noiret à son chevet l’encourageant, « Pousse Michel, ça décongestionne ! », puis lui tendant de grandes cuillerées de purée, « Mange, sinon tu ne vas pas mourir ! », tout cela avec rires et sourires : telles sont les premières images de Michel Piccoli (dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri) qui me sont venues à l’esprit en apprenant le décès de l’immense acteur.
Images (et sons !) saisissantes, iconoclastes, provocatrices, « punks », « scandaleuses » (de fait, le film avait secoué Cannes en 1973), images libertaires, gargantuesques, bien à la (dé)mesure du gigantesque et libre parcours de Piccoli, images de mort aussi, auxquelles on pense forcément en ce moment le concernant, en espérant que son vrai départ fut plus apaisé que dans le film de Ferreri mais tout aussi joyeusement entouré.
Incontinent chez Ferreri, Michel Piccoli était surtout un continent : 75 ans de carrière, 214 films, 3 réalisations, une cinquantaine de pièces de théâtre, une grande traversée de presque toute l’histoire du cinéma – il n’aura manqué que le muet et le réalisme poétique d’avant-guerre. La guerre, il la passe adolescent en Lozère, où il se découvre des amis juifs, un rejet éternel du fascisme (et du catholicisme inculqué par ses parents) et un engagement progressiste qui durera toute sa vie, du militantisme communiste au compagnonnage socialiste. Il débute tout juste après la guerre, en 45, et fait ses premières armes chez des cinéastes représentatifs de ce que la Nouvelle Vague théorisera plus tard avec une connotation négative « la Qualité Française » : Christian Jaque, Jean-Paul Le Chanois, Jean Delannoy… En 54, il apparaît dans son premier film notable, French cancan, chef-d’œuvre de Jean Renoir. Il y est un de ces bourgeois des beaux quartiers venant s’encanailler à Montmartre, et si l’on remarque son visage ténébreux et son timbre de voix tr