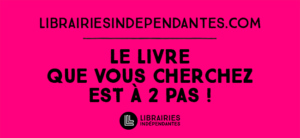« DADA est un microbe vierge » – sur la littérature à l’heure de la guérilla virale
Le mouvement dada, comme d’autres mouvements d’avant-garde au début du XXe siècle et plus tard, s’est pensé sur le mode de la contagion. Je voudrais revenir sur cette affirmation pour me demander si et comment elle peut aujourd’hui nous accompagner. On trouvera peut-être déplacé de parler de l’imaginaire du virus alors qu’il est encore si réel. Mais l’imaginaire, loin d’être « irréel », est une des manières de penser le réel, et son cheminement en littérature a de quoi nous faire réfléchir.
Le thème de la contagion traverse la littérature, et nombre de textes ressurgissent aujourd’hui au fil des réseaux sociaux : de Boccace à Manzoni, de Poe à King, de Camus à Giono… J’en suggère un à mon tour, passé je crois inaperçu : Je brûle Paris du futuriste polonais Bruno Jasienski. Publié en français dans L’Humanité entre septembre et novembre 1928, c’est le récit d’une épidémie de peste provoquée dans Paris par une victime du capitalisme. Pour contrer le fléau, la capitale mise en quarantaine se subdivise à son tour en micro-états communautaires, voire communautaristes, les riches tentant en vain de se préserver au détriment des pauvres, les pauvres élaborant des républiques humanistes mais vouées elles aussi à la mort. La peste s’arrête cependant aux murs des prisons où s’entassait le « prolétariat de Paris » rebelle, qui refonde à la fin Paris en « commune libre ». C’est ce lien entre virus et révolution qui va surtout m’intéresser ici.
Le virus apparaît ainsi comme la maladie même du capitalisme.
C’est à la fin du XIXe siècle, avec l’essor de la microbiologie et les travaux sur les maladies infectieuses (Pasteur, Koch, Yersin…), que le motif spécifique du microbe apparaît en littérature, d’abord dans des récits d’anticipation apocalyptiques traitant de la guerre bactériologique (Albert Robida ou H. G. Wells par exemple). Mais dès le début du XXe siècle, le propos change de nature : le virus devient l’une des figures par lesquelles s’exprime la volonté des arti