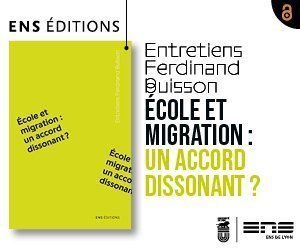Un âge de la contre-enquête – à propos de Mort d’un voyageur de Didier Fassin
« Il n’y a pas d’ethnographie sans écriture », la formule de Didier Fassin s’inscrit sans doute là dans l’histoire longue de l’ethnographie, émergeant peu à peu des belles lettres. C’est ce dialogue contrarié, entre ambition épistémologique et nécessité d’engagement formel, qu’ont montré Vincent Debaene dans L’Adieu au voyage ou plus récemment Eléonore Devevey dans Terrains d’entente. Une telle formule pointe que sciences sociales et littérature n’ont plus à être pensées comme des territoires antagonistes, avec leurs systèmes de légitimation, leurs effets de champ, leurs polarisations spécifiques ; mais comme des espaces frontaliers de tractations et d’échanges.
À la lecture du livre de Didier Fassin, Mort d’un voyageur. Une contre-enquête (2020), je souscris volontiers à la formule que Vincent Debaene a choisie en guise de sous-titre de son essai, entre science et littérature, pour dire cette place frontalière, non pas sur le mode du choix, mais sur celui de la contiguïté. Didier Fassin ne disait pas autre chose dans un entretien pour La Vie des idées : « L’ethnographie se situe à l’intersection du travail scientifique et du travail littéraire. J’essaie de défendre et de pratiquer les deux. Il y a un enjeu majeur, pour les sciences humaines et sociales, à n’en rabattre sur aucune de ces deux exigences. » C’est cette teneur frontalière que manifeste avec force et inventivité ce dernier essai.
Dans ces circulations frontalières, la littérature est saisie comme un réservoir d’expérimentations et de ressources formelles. Il ne s’agit pas d’aller puiser dans la littérature une ressource rhétorique ou un art du bien écrire, du beau style, mais de penser la création (littéraire) comme un moyen de problématiser le réel ou d’élaborer des propositions théoriques, ce que Didier Fassin a fait en emboîtant le pas aux ouvrages de J.M. Coetzee ou à la série de David Simon, The Wire.
Le chercheur donne un poids égal à chaque récit : il fait droit à toutes les versions