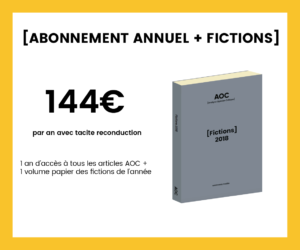La revanche du corps
À mesure que les semaines de confinement succédaient aux semaines de confinement, tandis que la maladie frappait et épuisait, la réalité incarnée de nos existences s’est imposée. Peu à peu, nous avons pris conscience de ces corps que nous devions à la fois protéger, contraindre et réconforter. Ce n’est pas tant que nous les ignorions jusque-là, mais ils étaient à notre service – pensions-nous, les outils utiles de nos vies quotidiennes. Avec l’enfermement, cette dimension pratique s’est effacée pour progressivement révéler le lien d’essence qui nous lie à nos corps. Au moins pour un instant, la crise aura ainsi modifié l’idée que nous nous faisons de notre condition humaine en ramenant au devant de sa définition notre foncière incarnation.
Selon une tradition dualiste bien enracinée, nous considérons et éprouvons nos corps sous le double signe de leur instrumentalité et de leur efficacité. Ils sont la forme de notre présence, le moyen de nos actions, le véhicule de nos relations. Nous avons des corps que nous entretenons (ou pas) comme on entretient un engin indispensable. Pour certain·e·s, cela se traduit par le souci d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière, pour d’autres, rien de spécial pourvu que cela fonctionne bien, pour d’autres encore, bombance et excès en tous genres à la recherche du plaisir maximal. Perfectionniste, indifférent ou hédoniste, tout dépend en fait du degré d’exigence qui est le nôtre relativement à ce que nous attendons de nos corps ; tout dépend aussi et sans doute surtout des ressources et du temps dont nous disposons.
Si elle est ancienne, voire immémoriale, cette appréhension fonctionnaliste de la corporéité a pris une ampleur inégalée à mesure que se répandait le mythe néo-libéral de l’accomplissement personnel et de la concurrence inter-individuelle. Doté·e·s à la naissance de capacités physiques équivalentes, il nous reviendrait de faire fructifier ce capital pour le mettre au service de nos desse