Ce que devient le politique – mi-temps de la crise 1/3
Le temps pour comprendre
Jacques Lacan
Crise : tel est donc le nom généralement admis pour ce que nous sommes en train de vivre. Mais que veut-il dire ? Est-ce que, d’ailleurs, il peut avoir le même sens pour tous, indépendamment de nos professions, de notre âge, de notre sexe ou de notre race, du pays où nous vivons et finalement de notre place dans le monde ? Est-ce qu’il conserve aujourd’hui le sens que lui avaient conféré ses usages historiques antérieurs, constamment renouvelés depuis que la pensée grecque classique a fait de la krisis une grande catégorie de la médecine et de la politique ?
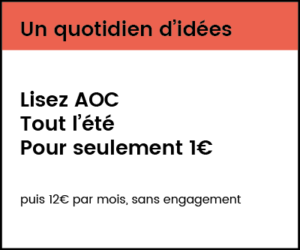
Rien n’est moins sûr mais – il est intéressant de le noter ici d’emblée – les deux usages originels, entre lesquels régnait une analogie liée à l’idée d’une urgence appelant une décision, semblent aujourd’hui devoir en quelque sorte fusionner en une figure unique. Un des objectifs de cette conférence sera de remettre en jeu la signification de ce que nous appelons une « crise », en tirant avantage (mais aussi en courant le risque) de ce qui est essentiellement une expérience incomplète, donc intrinsèquement équivoque. Le « moment de conclure », comme disait Lacan, n’est évidemment pas arrivé, bien qu’il nous importe essentiellement, vitalement, de chercher à penser ce qui nous arrive. Je ne veux pas, cependant, disserter abstraitement sur ce point, et j’essayerai plutôt d’en dégager quelques déterminations qui me semblent incontournables en effectuant les détours nécessaires pour y parvenir.
J’examinerai successivement trois points, associant chaque fois une question générale et le rappel d’un trait saillant de notre expérience actuelle, singulière et contingente. Je commencerai par la fin : savoir ce que devient la politique dans la crise, en prenant pour témoin le surgissement inattendu des manifestations contre le racisme d’État aux États-Unis et ailleurs, et le sens qu’on peut conférer au fait que le mot d’ordre « Black Lives Matter » résonne ainsi à travers le monde
