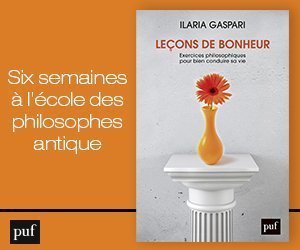« Tech for good », ou « good for tech» ? La technologie au service de la soutenabilité
Situation vécue : nous déambulons dans un salon international sur les « techs for good », qui réunit un bon millier d’investisseurs, entrepreneurs, scientifiques, ingénieurs, geeks, consultants et étudiants souhaitant promouvoir des solutions technologiques innovantes adressant les grands problèmes du monde et de la société. Tout est en anglais, avec un parterre d’intervenants internationaux très majoritairement anglo-saxons éclairant les dernières tendances technologiques.
Dans un « start-up corner », nous discutons avec un entrepreneur concourant pour le prix de la meilleure start-up. Un drone dans les mains, l’entrepreneur nous explique sa solution : le drone embarque un système de repérage optique permettant d’identifier les mauvaises herbes résistantes aux herbicides non-sélectifs (du type round-up). En effet, si un herbicide total élimine théoriquement tous les parasites, pour ne laisser intactes que les plantes génétiquement modifiées, au fil du temps certaines mauvaises herbes se sont adaptées pour devenir résistantes au glyphosate, se multipliant très vite et envahissant des champs de colza ou maïs. Sa solution offre alors deux bénéfices : un repérage précoce des mauvaises herbes qui peuvent être arrachées avant qu’elles envahissent le champ, et des coûts en main d’œuvre réduits pour inspecter les champs. Sa solution s’inscrit ainsi comme un moyen d’accroître les rendements agricoles et réduire la faim dans le monde et promouvoir une agriculture durable…
Au-delà des perspectives commerciales avec les grandes exploitations agricoles, l’entrepreneur met en avant l’utilité de son invention pour les géants de la biotechnologie, qui pourront, à travers l’intelligence des données collectées (smart data) améliorer leurs processus de sélection génétique. Lorsqu’on l’interroge sur l’impact de son modèle sur la biodiversité, l’artificialisation des sols ou l’impact pour les petits exploitants, l’entrepreneur nous dit qu’il s’agit d’autres enjeux, pas vraim