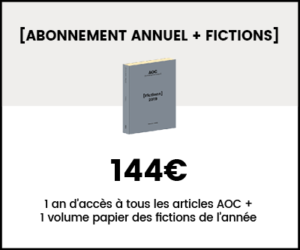L’universel, seule voie possible de l’émancipation
Jamais nous n’avons été aussi conscients de former une seule humanité. L’extraordinaire progression des moyens de transport et de communication, notamment depuis l’Internet et le développement des réseaux sociaux, renforce chaque jour cette conscience horizontale d’humanité globale. En outre, nous savons que nous sommes exposés aux mêmes risques planétaires : épidémies, changement climatique, catastrophe nucléaire, épuisement des ressources naturelles, extinction des espèces, crise économique mondiale, etc. Et pourtant l’unité de l’humanité et les valeurs universalistes qui lui sont associées reculent dans les représentations collectives. À droite comme à gauche.
À droite, les replis identitaires et xénophobes qui ne cessent de progresser, d’un bout du monde à l’autre (Trump, Modi, Bolsonaro, etc.) et aux deux extrémités de l’Europe (Brexit, Orbán, etc.), s’opposent aux immigrants, aux étrangers, aux envahisseurs, au « grand remplacement ». On connaît la critique : le « droits-de-l’hommisme hors sol » écrase les identités « enracinées ».
À gauche, sous l’influence de la New Left américaine, on repense en termes d’identités antagoniques (de race, de genre, d’orientation sexuelle, etc.) les conflits que l’on pensait naguère en termes de lutte de classes. Et la vieille critique, détournée d’un marxisme simplifié, revient : l’universel ne serait au fond que le « droit du plus fort ». Il est assimilé tantôt au patriarcat (tous les hommes, mais pas les femmes), tantôt à la « blanchité » (tous les hommes, mais seulement les mâles blancs), à l’européocentrisme (tous les hommes, mais seulement occidentaux), ou à l’anthropocentrisme (tous les hommes, mais pas les animaux), etc.
En somme l’universel ne serait jamais vraiment universel. Ou lorsqu’il l’est, il l’est trop : oublieux des « nations » ou des « victimes », des « cultures » ou des « religions des dominés », et même des « races » – car cette notion ressort actuellement de la poubelle de l’histoire où l’avaient relégu