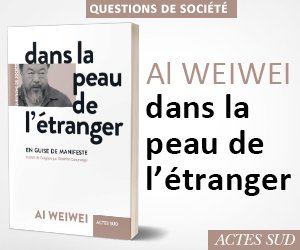Libérer l’écologie de l’imaginaire effondriste
Selon un sondage très souvent cité, 65 % des Français jugeraient que « la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir ». Qu’entendent-ils exactement par « s’effondrer » ? Le sondage ne le précise pas. Mais il incite à croire que l’effondrement est la conviction partagée d’une majorité de Français. Objet d’une théorie particulière, la collapsologie, popularisée, notamment, par les livres de Pablo Servigne ou d’Yves Cochet, l’effondrement tend à devenir la référence commune de la pensée écologique.
Sans doute, dans la galaxie écologique, tout le monde ne se dit-il pas collapso, mais tout le monde semble l’être un peu, de peur de passer à côté de l’évidence ou d’être assimilé à un climatosceptique, à un défenseur du « business as usual ». Tout se passe comme si la pensée de l’effondrement avait absorbé l’écologie dans son ensemble.
Pour envisager l’avenir, « le monde d’après », devons-nous le penser à l’horizon d’un effondrement planétaire ? Nous soutenons la thèse opposée : bien loin d’être la condition pour comprendre la situation actuelle et envisager les possibles, la collapsologie est ce qui en masque les enjeux.
Du probable au certain
À voir l’état de la planète, il y a certes de bonnes raisons d’être inquiet. On n’en finit pas d’énumérer les catastrophes : celles qui ont déjà eu lieu (liées à l’industrie chimique comme à Bhopal ou à Seveso, ou à l’industrie nucléaire comme à Tchernobyl ou à Fukushima), celles que le changement climatique provoque ou renforce (inondations, cyclones, montée du niveau des mers rendant certains lieux inhabitables, multiplication des mégafeux dont on ne peut venir à bout, comme en Sibérie chaque été, ou en Australie l’hiver dernier), disparition d’espèces et diminution accélérée des effectifs des espèces communes … il faut vraiment s’illusionner pour ne pas en tenir compte ou affirmer qu’on en viendra à bout avec quelques innovations techniques.
Force est de constater qu