Le fragile accord de relance européen
Le 21 juillet dernier, les chefs d’État et de gouvernement européens se sont mis d’accord sur un plan de relance de l’économie européenne après sa mise à l’arrêt par l’épidémie de Covid-19. Comme toujours après un conseil européen difficile, tous les participants ont déclaré qu’ils avaient gagné ; cette manière de présenter les négociations européennes comme un affrontement entre États dans lequel chacun doit arracher une victoire sur ses partenaires, cela en dit long sur la solidarité et l’esprit fédéraliste qui règnent au sein de l’Union européenne.
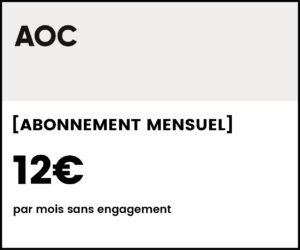
Les médias ont mis en valeur le rôle décisif de leurs représentants nationaux et insisté sur le caractère « historique » des décisions prises. Puis comme toujours, les polémiques sont venues, d’autant plus bruyantes que les résultats de la négociation avaient été présentés avec emphase et beaucoup d’approximation.
Nous essayons ici de présenter une évaluation aussi objective que possible de cet accord, en rappelant que le Conseil européen devait se prononcer en même temps sur un plan exceptionnel de relance et sur le budget de l’Union européenne de 2021 à 2027. Deux sujets dont l’articulation présente de nombreuses difficultés : un plan de relance de l’économie européenne frappée par la récession consécutive à la pandémie et le budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027.
Ces discussions présentaient à la fois un caractère budgétaire et financier – combien dépenser et comment dépenser –, et une dimension politique, puisqu’il s’agissait d’autoriser la Commission européenne à emprunter sur les marchés financiers 750 milliards d’euros (la Commission a déjà emprunté mais jamais des sommes aussi importantes) pour financer le plan de relance en lieu et place des États membres et de trouver de nouveaux moyens de financer les dépenses européennes.
Un plan de relance et non un nouveau cadre budgétaire européen
Le Conseil européen a autorisé la Commission à emprunter au maximum 750 milliards d’euros sur les marchés f
