Laïcité, islam et « séparatisme » : le confusionnisme de l’exécutif
Dans son allocution prononcée le 4 septembre au Panthéon à l’occasion du 150eme anniversaire de la proclamation de la Troisième République, Emmanuel Macron a affirmé que la « République n’admet aucune aventure séparatiste », dans la continuité du discours prononcé à Mulhouse le 18 février dernier. Le président de la République y avait défini la priorité de la lutte contre un « séparatisme islamiste » et annoncé un projet de loi dans ce sens pour l’automne.
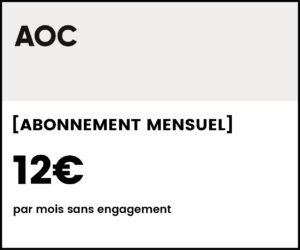
Les premiers éléments ont été récemment dévoilés dans le cadre d’une campagne de communication dramatisée et orchestrée par le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa.
Cette nouvelle séquence se révèle être symptomatique de la politique menée par Emmanuel Macron sur ces questions depuis le début de son mandat, dans la droite ligne notamment des deux précédentes initiatives avortées de l’exécutif. Qu’il s’agisse de l’organisation du culte musulman et, pour y parvenir, de la réforme de la loi sur la séparation des Églises et de l’État, il y avait là autant de propositions et de projets mort-nés qui, en plus de porter atteinte à la neutralité de l’État en matière religieuse, ont contribué à diffuser largement un double message de façon plus ou moins subliminale. Cette religion ne se serait pas pleinement soumise au cadre juridique laïque et les dérives idéologiques marginales auxquelles elles donnent lieu seraient presque exclusivement dues à des influences étrangères qu’il faudrait, même surestimées ou fantasmées, contrecarrer.
Si elles se traduisent par un projet de loi, les dernières propositions envisagées seront décalées et condamnées à l’inefficacité pour endiguer de surcroît un phénomène limité. Il n’est visiblement plus question d’imams, de financement étranger du culte musulman ou d’enseignement de l’arabe, c’est-à-dire les principaux chantiers contenus dans le discours de Mulhouse. Les mesures cibleraient désormais toutes les association
