Résilience, vous avez dit résilience ?
Ayant déferlé en France depuis les années 1980 avec les théories du trauma, à partir d’une référence obligée à Boris Cyrulnik, très vite entré dans la sphère du développement personnel et de la psychologie populaire, le concept de résilience a nouvellement pris avec la crise du Covid-19 une dimension idéologique et économique centrale – on se souvient que c’est le nom de l’opération lancée le 25 mars 2020 par l’armée française pour contribuer à la « guerre » contre l’épidémie. L’instrumentalisation jusqu’à la propagande, sa circulation complexe entre résistance, reliance, solidité, sûreté, autorégulation, imposent d’en faire la généalogie morale et politique. Devenue concept politique, la résilience impose une critique politique.
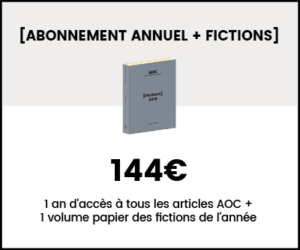
« On vivait dans la profusion de tout, des informations et des “expertises”. Il y avait de la pensée sur l’événement sitôt survenu, les façons de se comporter, le corps, l’orgasme et l’euthanasie. Tout se discutait et se décryptait. Entre “addiction” et “résilience”, “travail de deuil”, les moyens de mettre sa vie et ses émotions en mots pullulaient », raconte Annie Ernaux en décrivant le tournant des années 2000 à l’heure de la naissance d’Internet comme sphère pulsionnelle, de l’information mondiale en temps réel et de la démocratisation des pratiques d’auto-analyse.
La résilience, banalisée en deux décennies jusqu’à devenir le concept fourre-tout des innombrables manuels de la psychologie positive et des romans qui les accompagnent (pensons simplement au best-seller Nos résiliences d’Agnès Martin-Lugand vendu à plus de trois millions d’exemplaires) appartient en bonne part au nouveau vocabulaire de saisie de l’expérience et de connaissance de soi. Elle est indissociable de ce que le sociologue Danilo Martucelli nomme « l’auto-émancipation » du sujet à un moment historique où notre vie singulière est « devenu l’horizon liminaire de notre perception sociale ».
L’histoire de la notion psychologique de résilience permet d’éclairer quelque p
