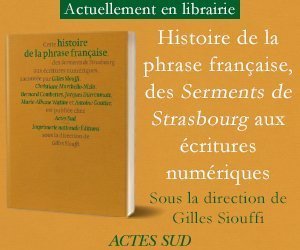Le véhicule des images – sur l’exposition « L’aventure générale » d’Alain Fleischer
Une « Aventure générale » : l’œuvre d’Alain Fleischer est sans doute cela, une vaste narration, une aventure généralisée à tous les domaines, à mille pratiques, aux mots et aux images, aux images et aux mots, selon les termes d’Alain Fleischer – générale et générique. Une exposition dense de son œuvre nous est ainsi proposée au Centquatre par les commissaires Danielle Schirman et Dominique Païni, et sous la direction artistique de José-Manuel Gonçalvès : dans les différents bâtiments divisés en ateliers, elle occupe de nombreuses salles regroupant les travaux d’une série, ou au contraire consacrées à des dispositifs ou des installations uniques.
Les œuvres sont des photographies, des sculptures, des scénographies ; elles sont de mots et d’images, figées ou animées, en surgissement visible dans le processus chimique de leur révélation, ou dans l’obscurcissement progressif qui les fera disparaître. Elles sont tout cela, et tout cela à la fois, plurielles en chacune comme l’est toujours, et peut-être systématiquement, la pratique d’Alain Fleischer, même si celui-ci demeure mieux connu pour ses pratiques de l’image et de ses techniques que pour la somme imposante de ses écrits, sculptures et installations nombreuses.
Quelques unes de ses œuvres les plus connues sont par ailleurs visibles dans l’exposition : le reflet d’un visage le long d’un couteau à beurre ou l’ombre d’un autre, portée par les plis d’un drap. Différents visages de femme, dont certains sont des portraits reflétés dans des cadres ou des visages de statue sans yeux, et qui tous se rejoignent dans leur statut d’image, comme une présence sur un autre mode, sur un autre ton, d’un autre temps.
Dans ce qu’elle a pourtant de partiel puisqu’elle ne retient que quelques images comme des clichés photographiques, leur notoriété singulière est aussi justement signifiante. En premier lieu, si de Fleischer les images se laissent plus facilement connaître, c’est qu’elles durent et perdurent, survivent et pe