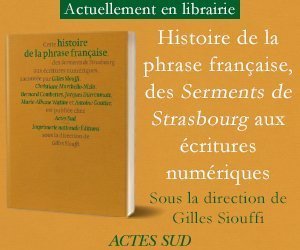Panique d’État
Dans un passage saisissant de la conclusion de l’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique de 1943, devenu à la faveur de l’édition de 1966, la première partie du livre Le Normal et le Pathologique, Canguilhem écrit que « le pathologique traduit […] la précarité du normal établi par la maladie »[1]. Cette formule, qui établit que le normal est précaire tant sa signification est cousue à celle de la maladie, prend peut-être pour nous lecteurs d’aujourd’hui une portée plus grande encore et nous oblige très certainement à nous interroger à nouveaux frais sur les relations du normal et du pathologique. Ne sommes-nous pas à un moment où l’assurance dans notre pouvoir de vivre et le sentiment de pouvoir disposer de sa santé ont chuté ?
Cette précarité des normes vitales, démultipliée par l’épreuve de la Covid-19 est également un événement social. Ne sommes-nous pas également dans un présent où, à force d’une précarisation de toutes les normes sociales qui semblaient pourtant les plus robustes, parmi lesquelles l’institution du travail sur site, l’institution scolaire, universitaire, la division entre travail et loisir et, par-delà, toutes les institutions du normal, nous ne parvenons plus réellement, sur le plan social, à distinguer le normal du pathologique ? C’est ce que cet article entend suggérer. Il s’emploiera pour y parvenir à revisiter les concepts de normal et de pathologique sur les plan vital et social chez Canguilhem tout en s’orientant vers une compréhension de nos normes sociales à partir des expériences du confinement, du déconfinement et du reconfinement auxquelles nous avons été et sommes encore confrontés.
Le plus troublant, dans la crise actuelle, réside en effet peut-être moins dans le fait de l’épidémie, dont les vagues successives n’ont cessé de traverser notre histoire – même si nous avions pu finir par nous croire invulnérables et penser faussement qu’il s’agissait d’abord de l’histoire des autres, à commencer